Site atelier de FONTAINEBLEAU
Informations générales
| Localisation : | Forêt domaniale de Barbeau, Seine et Marne (77) |
| Longitude/latitude : | 48°28'35'' N, 2°46'49'' E |
| Altitude moyenne : | 92 m |
| Année de démarrage : | hiver 1993-1994 |
| Projets : | Carboeurope-IP, Euroflux-Carboeuroflux, Intégration dans le réseau européen ICOS |
Contact : /
 Voir le site web dédié au site atelier
Voir le site web dédié au site atelier

UMR Ecologie Systématique et Evolution (ESE) - UMR 8079
Université Paris-Sud
91405 Orsay cedex
Tél. : (33.1) 69 15 64 27 / 56 80
fax : (33.1) 69 15 72 38
Environnement
| Climat | |
| température moyenne annuelle : | 10,5°C |
| précipitations moyenne annuelle : | 690 mm |
| Végétation | |
| espèce dominante: | Chêne sessile (Quercus petraea) |
| autres espèces : | Charme (Carpinus betulus) – Alisier torminal (Sorbus torminalis) |
| Sols | |
| type de sol : | Gleyic Luvisol (FAO-ISRIC-ISSS 1998) |
| matériel parent : | Meulière de Brie (Sannoisien) et Argiles à Meulière (2 à 10 m) surmontées par les limons des plateaux d’origine éolienne (20 à 80 cm). Sous la meulière, les marnes vertes forment une couche imperméable |
| texture : | variant des Limons sableux aux Limons sablo-argileux ou encore Limons argilo-sableux en surface ; Argileux en profondeur. |
Recherche / objectifs
Objectifs généraux :
L'objectif principal du dispositif installé en forêt domaniale de Barbeau est de quantifier les échanges de
matière (CO2 et H2O) et d’énergie entre la forêt et l'atmosphère. La mesure en continu des teneurs absolues de
l'air en dioxyde de carbone et en vapeur d'eau et des trois composantes directionnelles de la vitesse du vent
permettent de calculer les flux net de CO2 et H2O. La mesure concerne une surface (empreinte au sol) de
quelques centaines de mètres autour de la tour qui est fonction de la vitesse et de la direction du vent
(« méthode des corrélations turbulentes »). L’autre axe majeur du dispositif vise à étudier et comprendre les
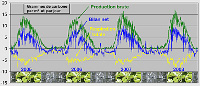 processus élémentaires (photosynthèse, respirations, transpiration, évaporation, etc.) qui sont à l’origine
des flux nets mesurés.
Pour ce faire, de nombreuses mesures sont réalisées sur les différentes composantes des
arbres et du sol (respirations des troncs et du sol, flux de sève, humidité du sol, etc.).
Au final, l'ensemble de ces mesures permet d’améliorer la compréhension du fonctionnement de la forêt. Les connaissances
acquises sont utilisées pour affiner les modèles de fonctionnement des écosystèmes forestiers développés au
laboratoire.
processus élémentaires (photosynthèse, respirations, transpiration, évaporation, etc.) qui sont à l’origine
des flux nets mesurés.
Pour ce faire, de nombreuses mesures sont réalisées sur les différentes composantes des
arbres et du sol (respirations des troncs et du sol, flux de sève, humidité du sol, etc.).
Au final, l'ensemble de ces mesures permet d’améliorer la compréhension du fonctionnement de la forêt. Les connaissances
acquises sont utilisées pour affiner les modèles de fonctionnement des écosystèmes forestiers développés au
laboratoire.

 Accès réservé
Accès réservé