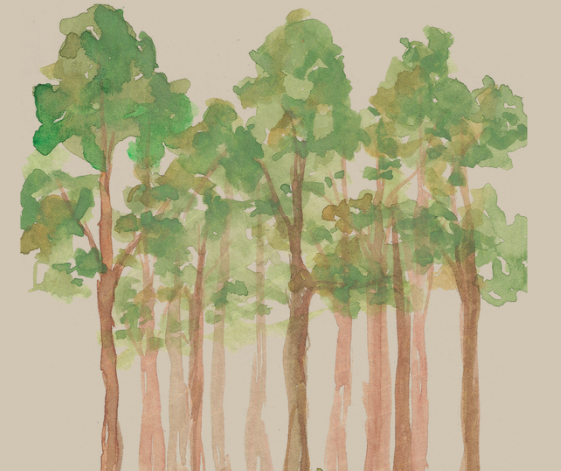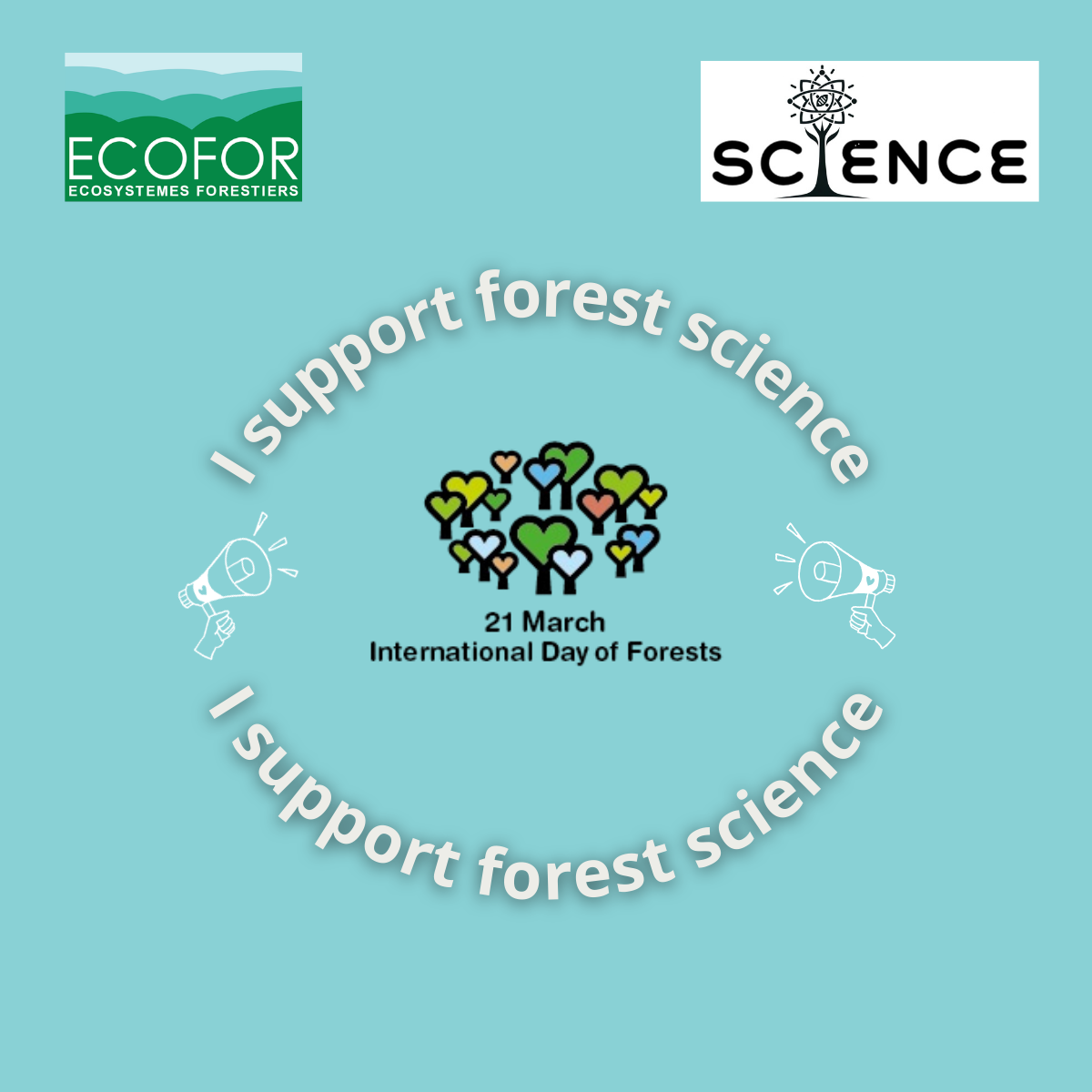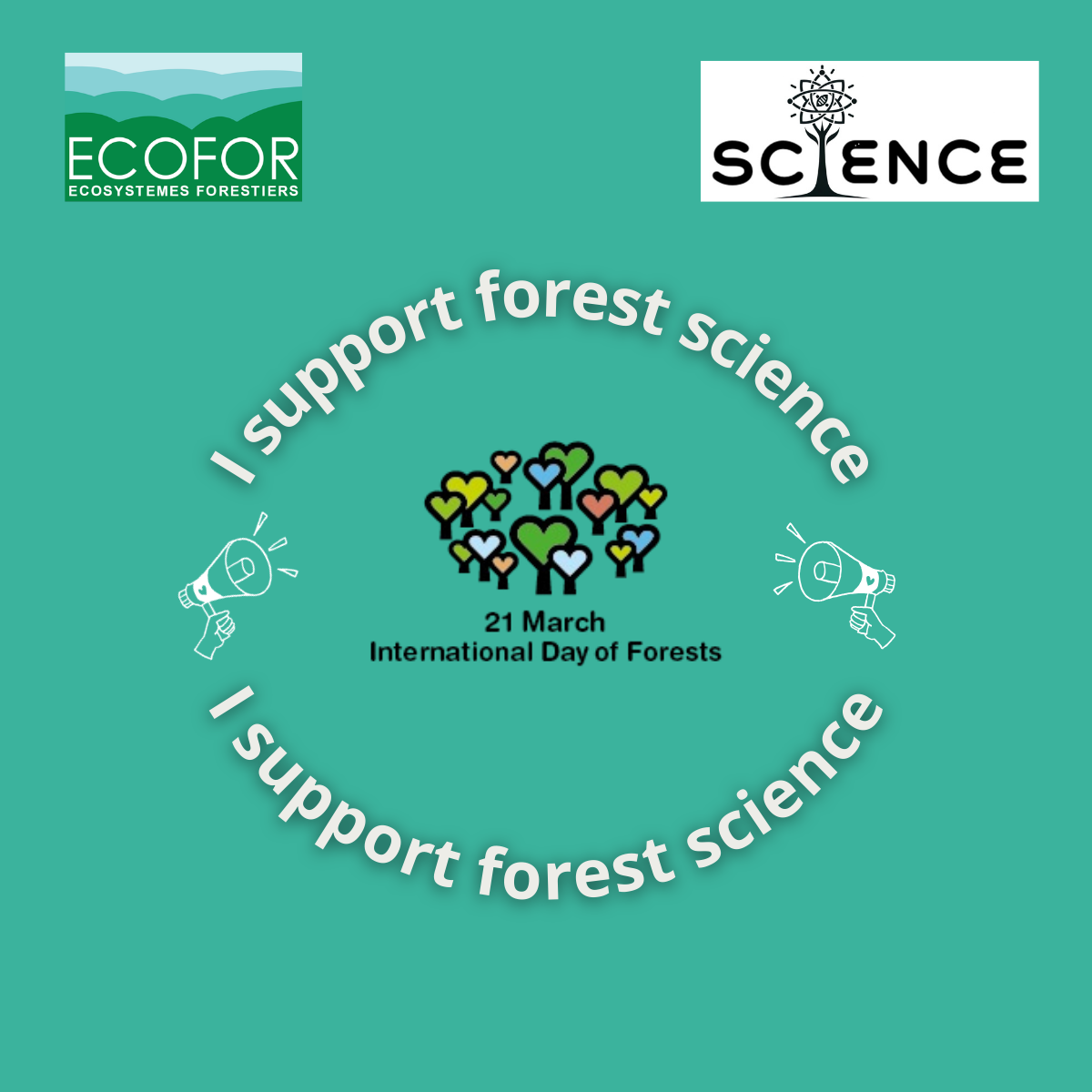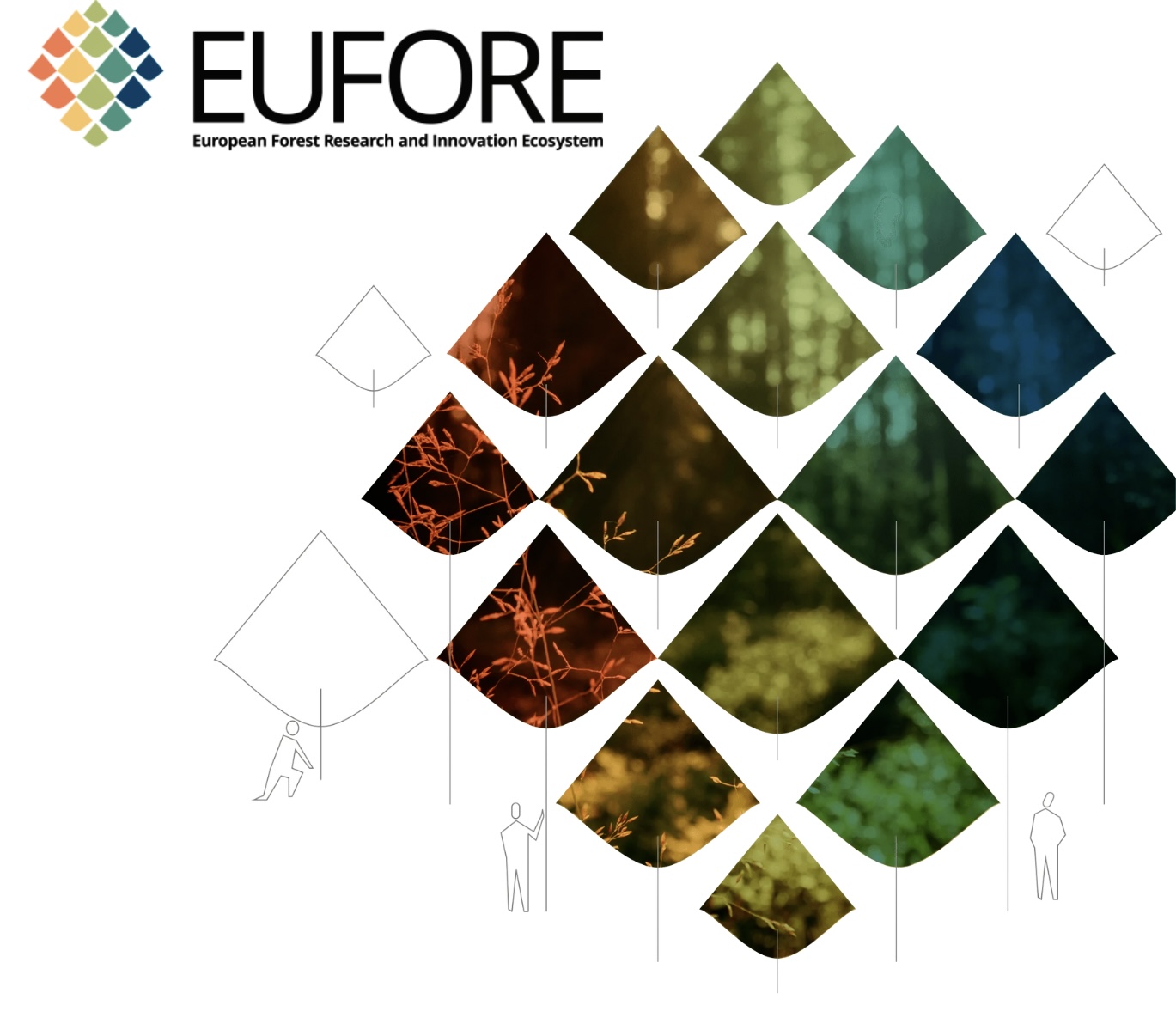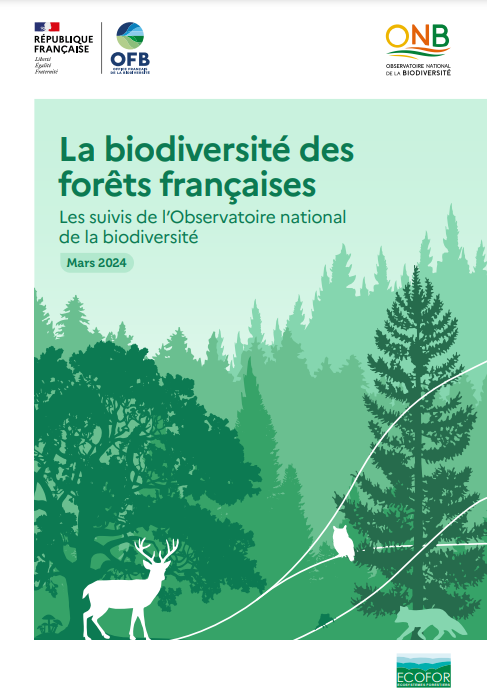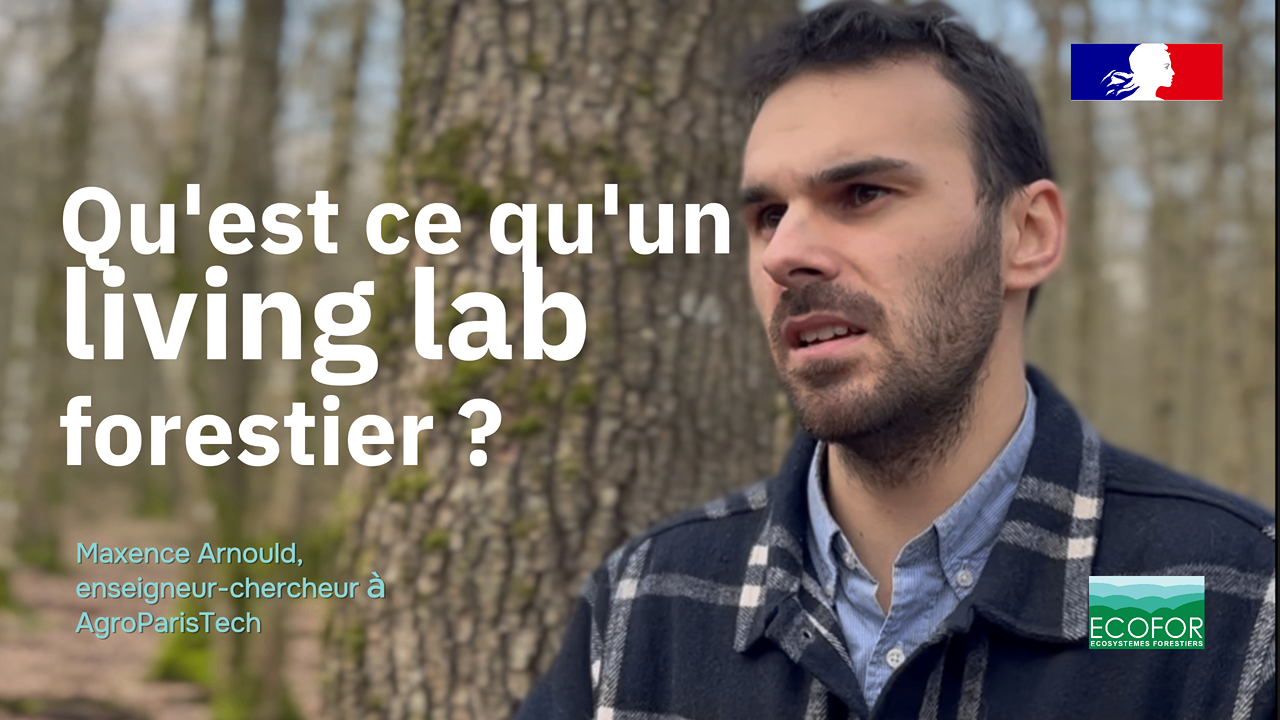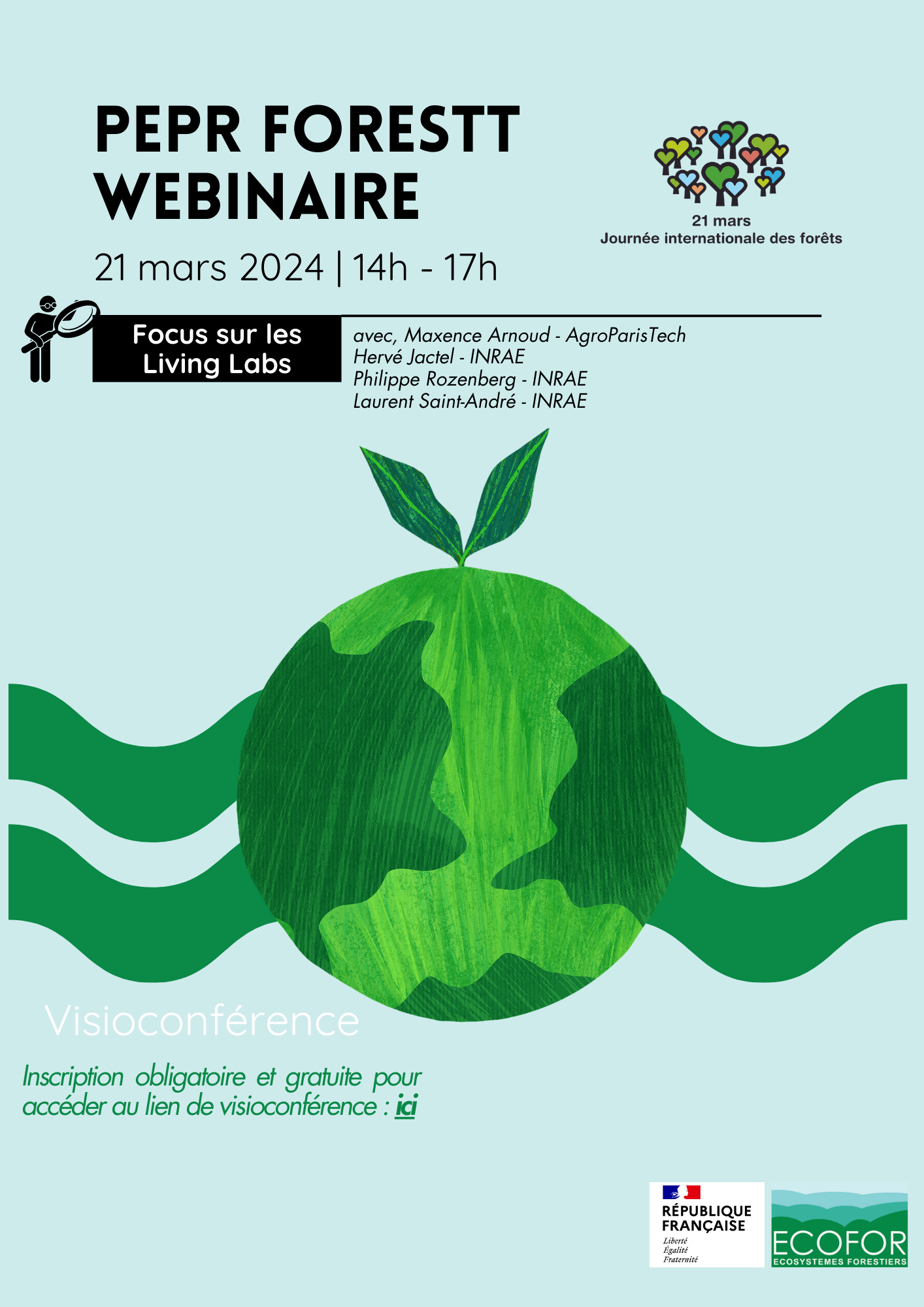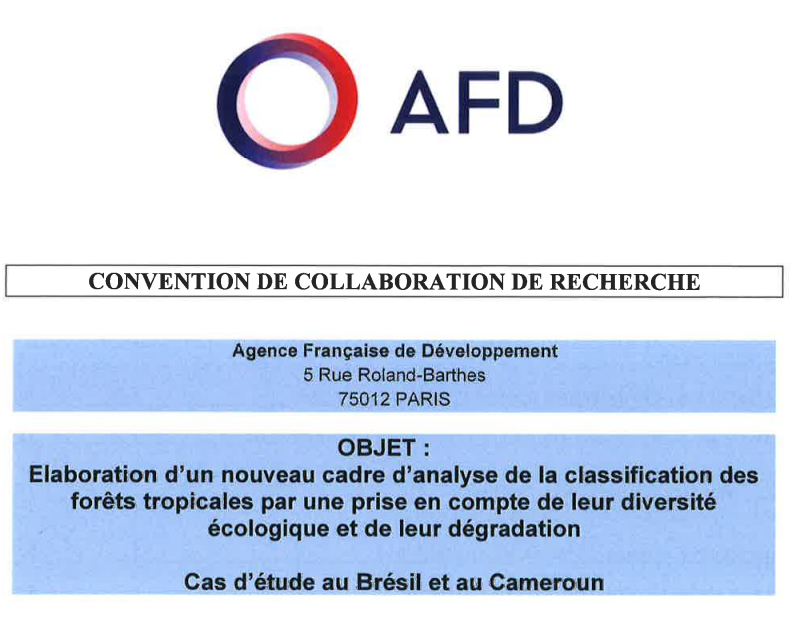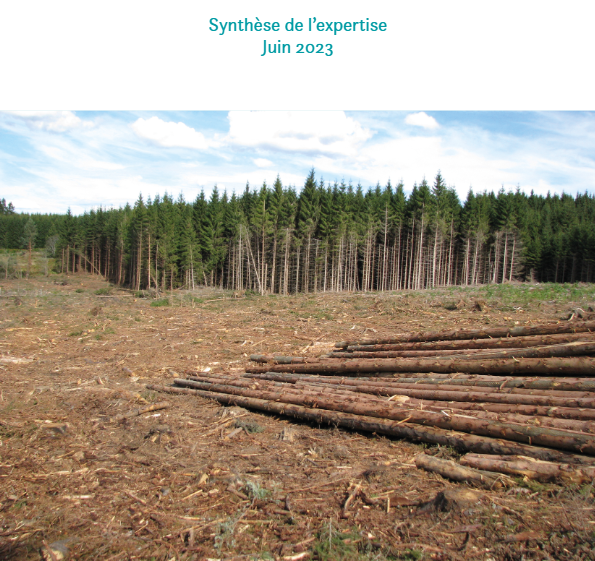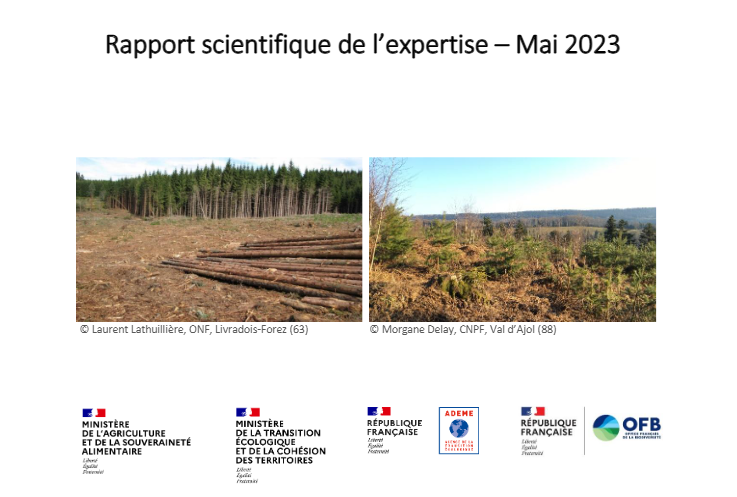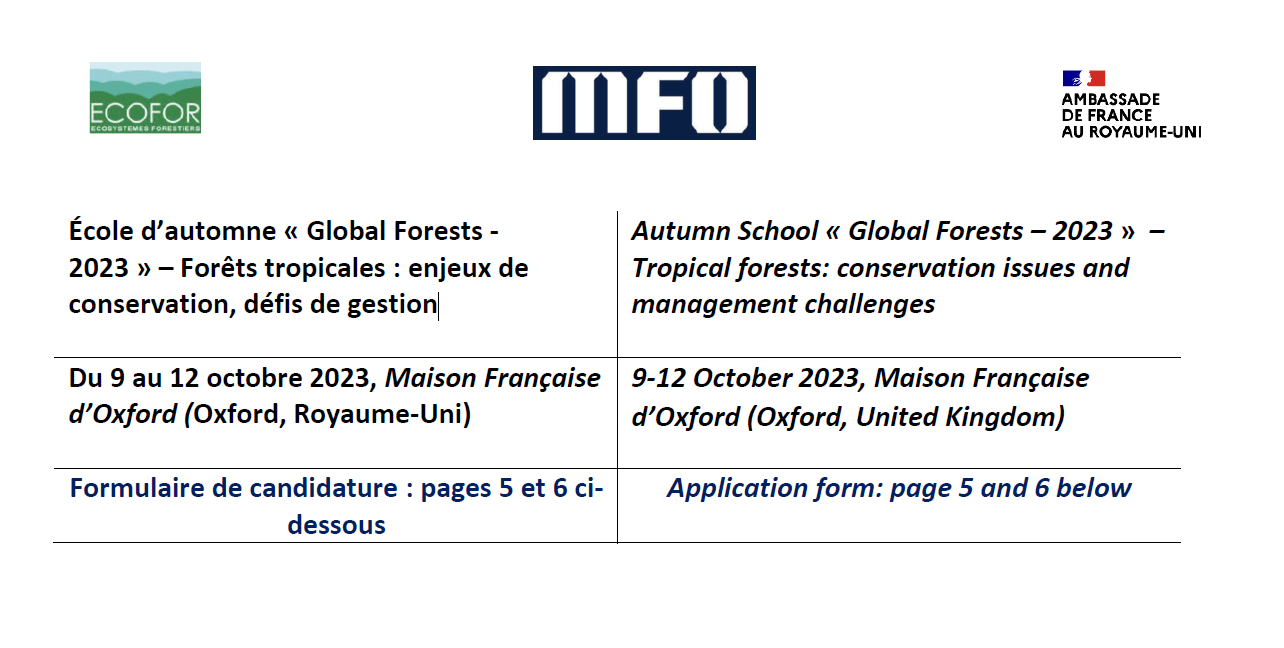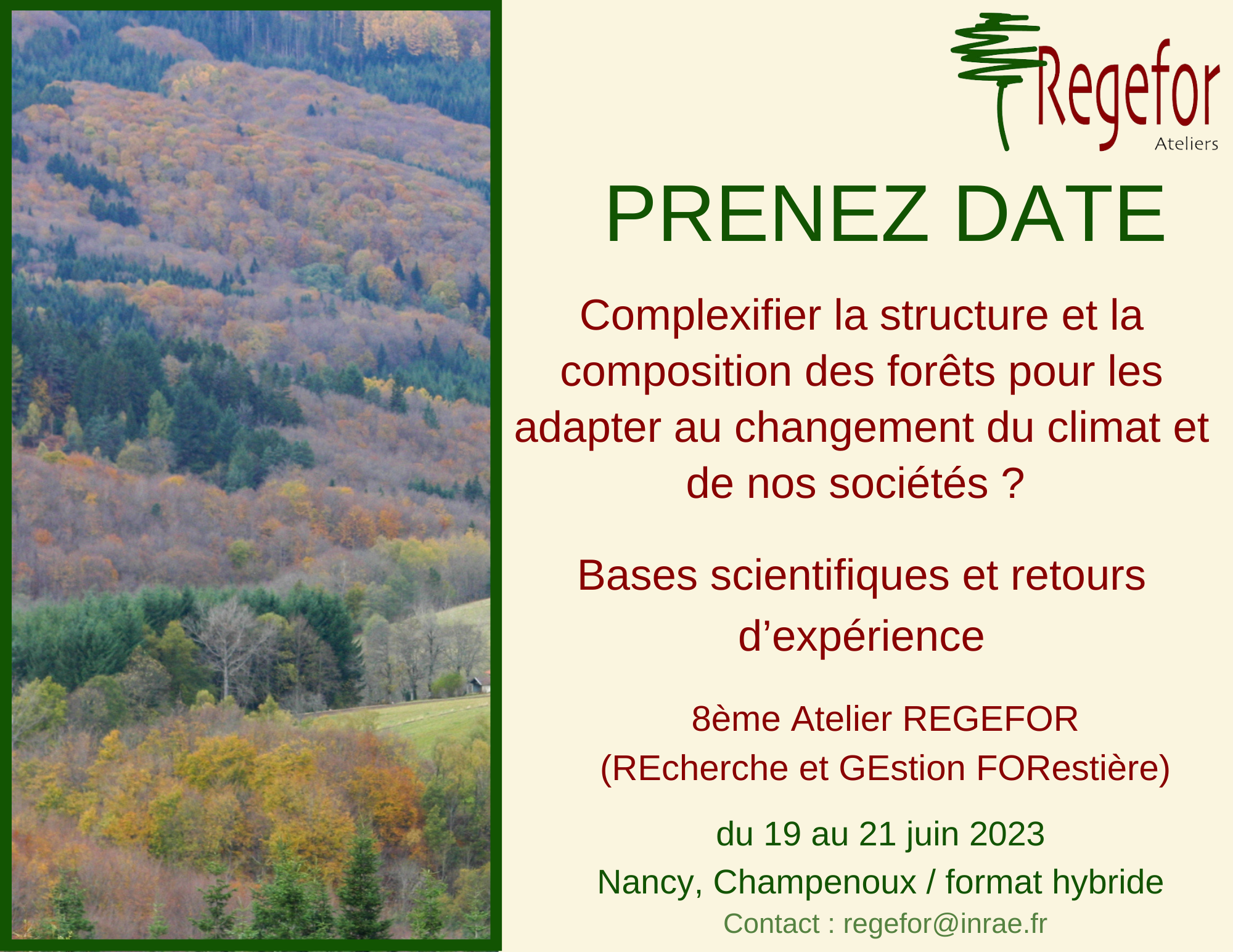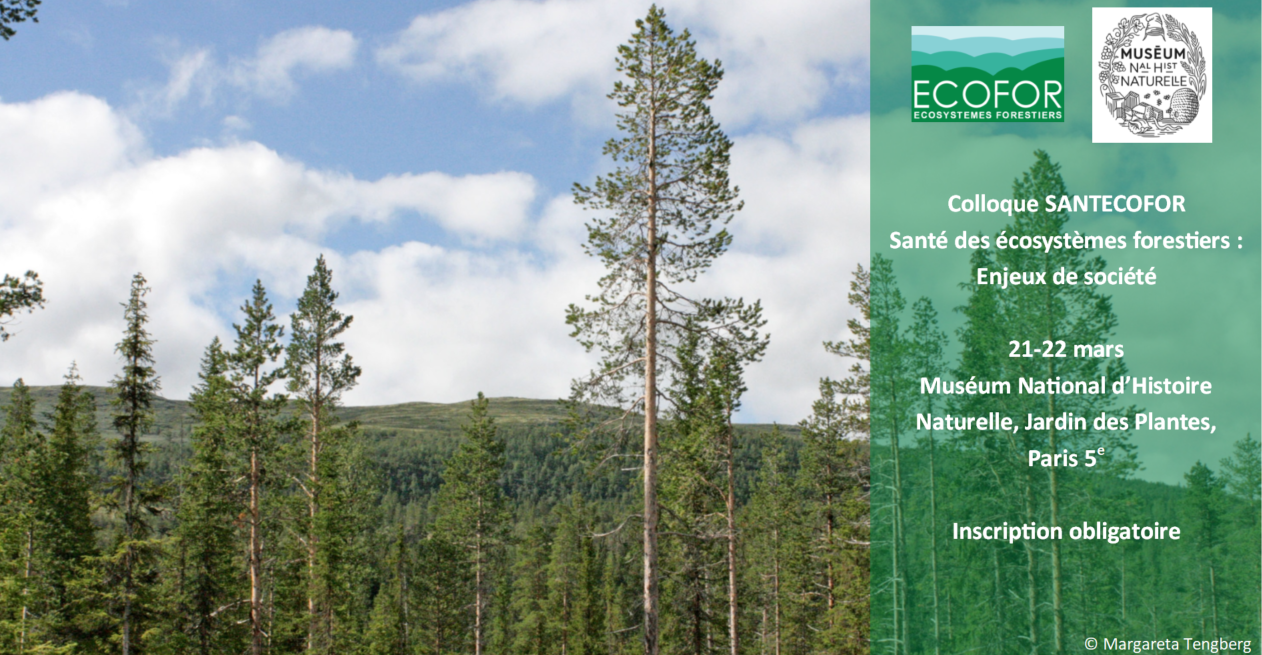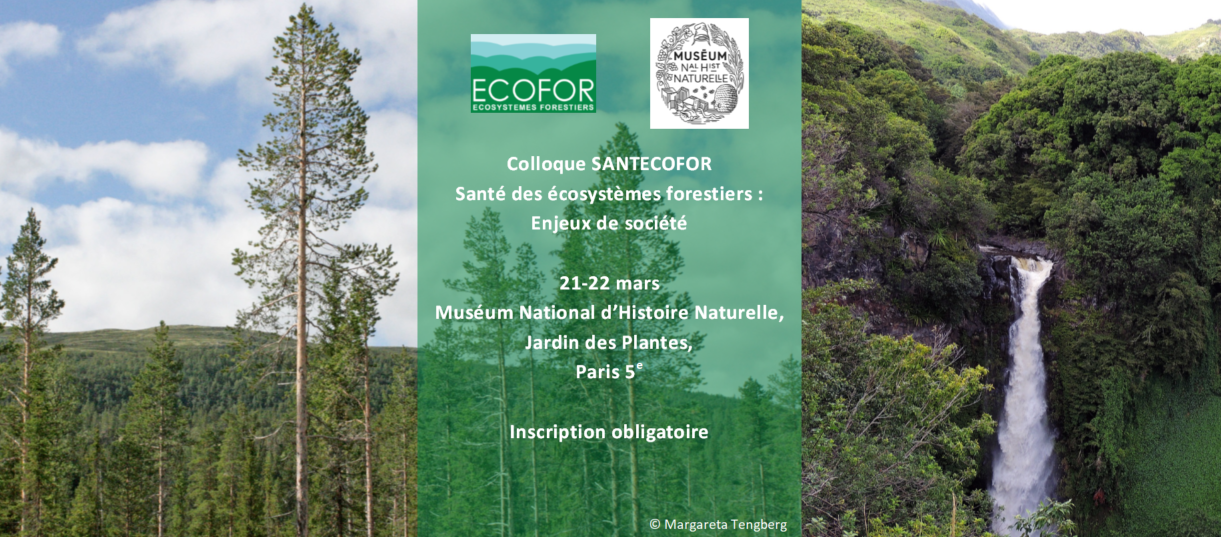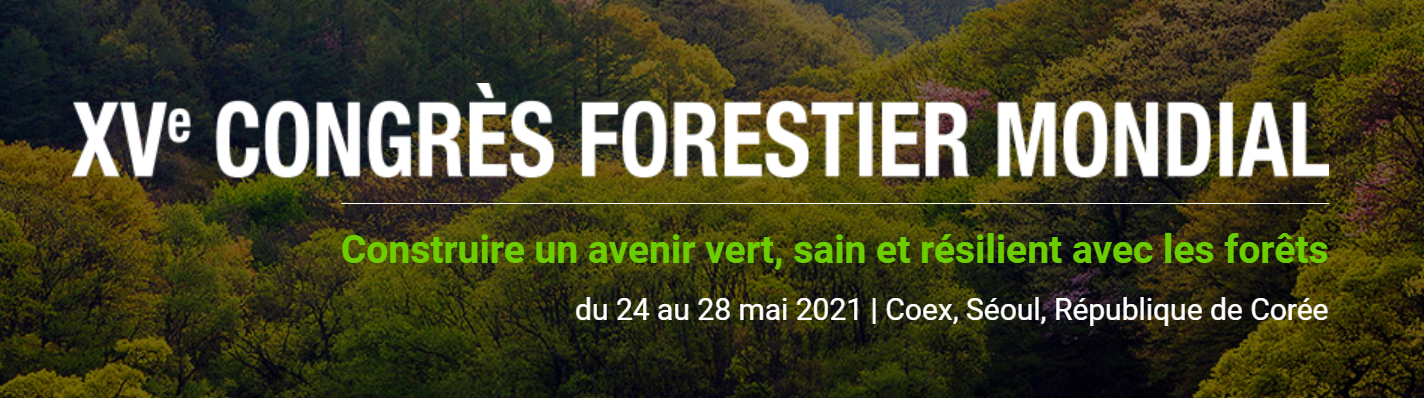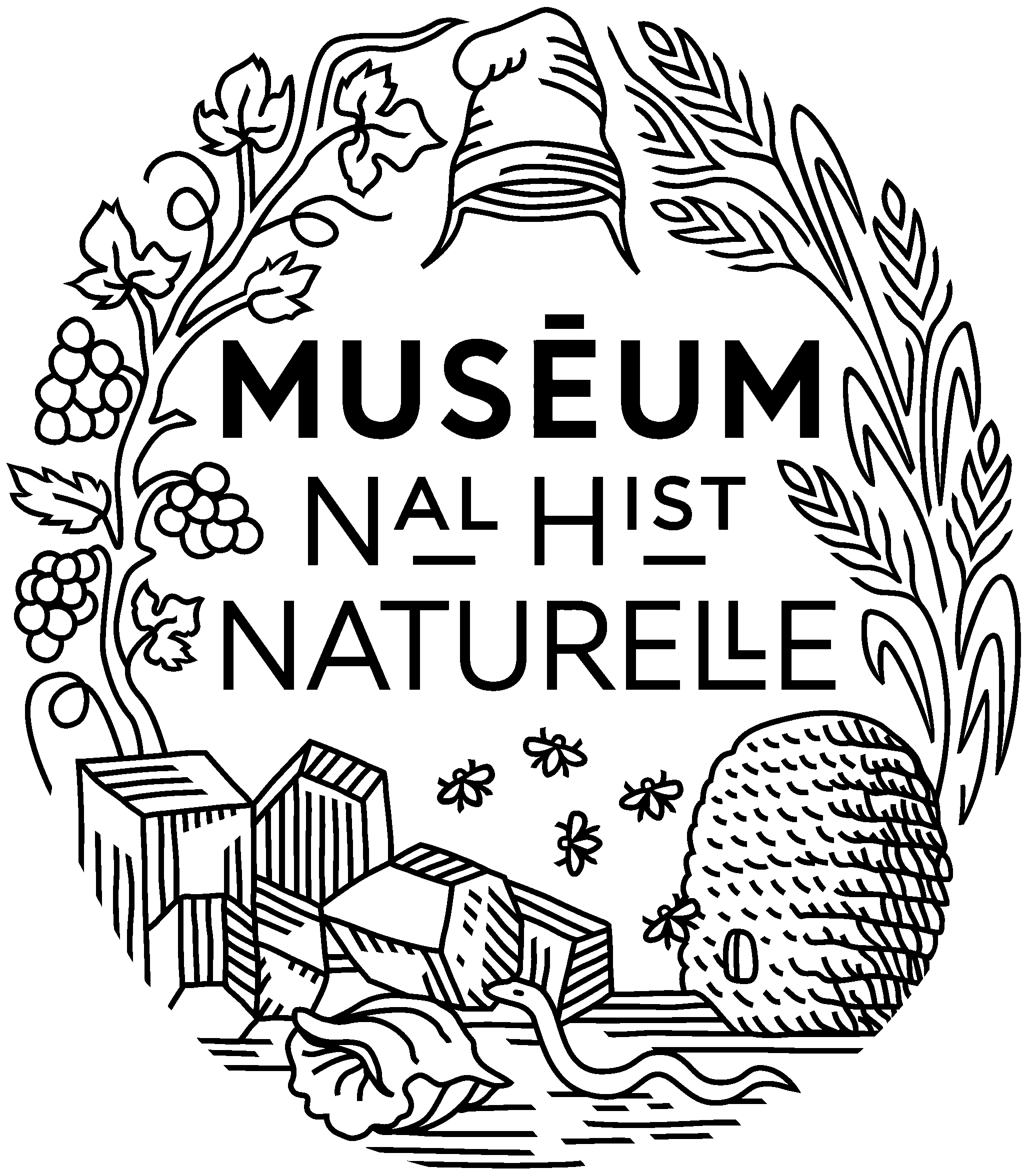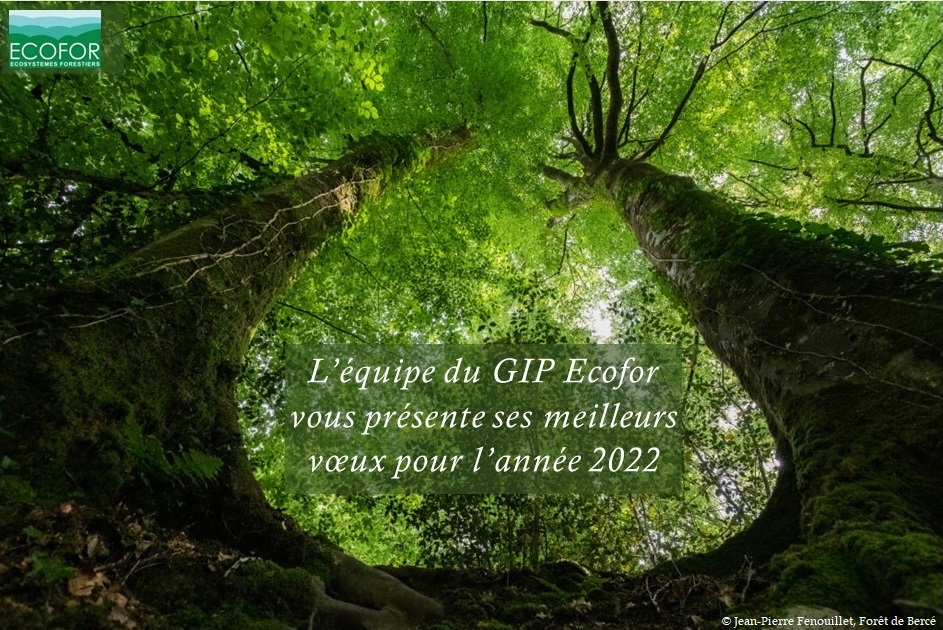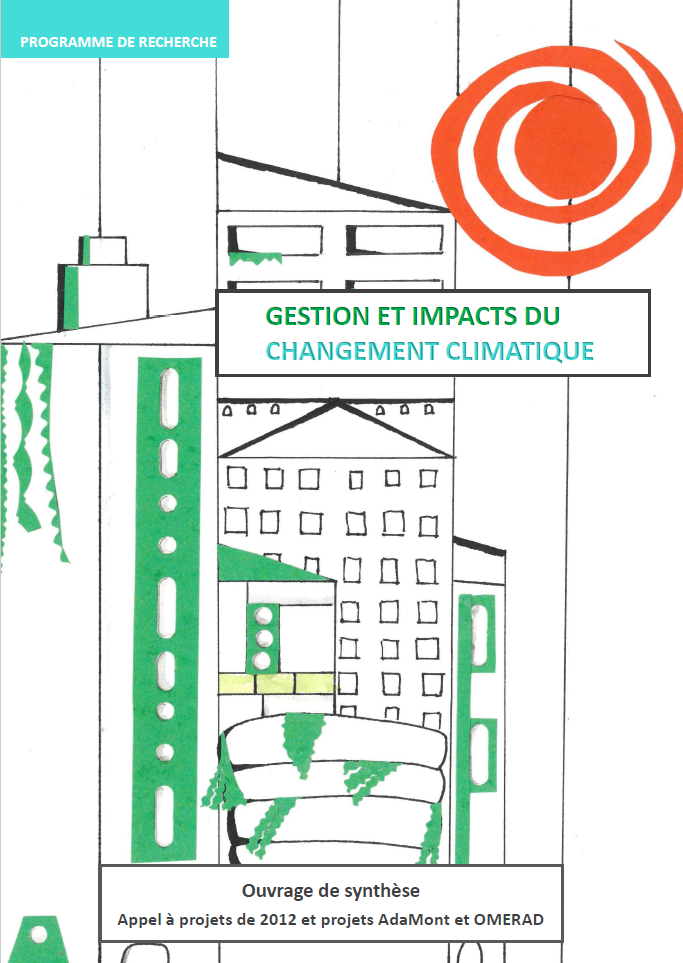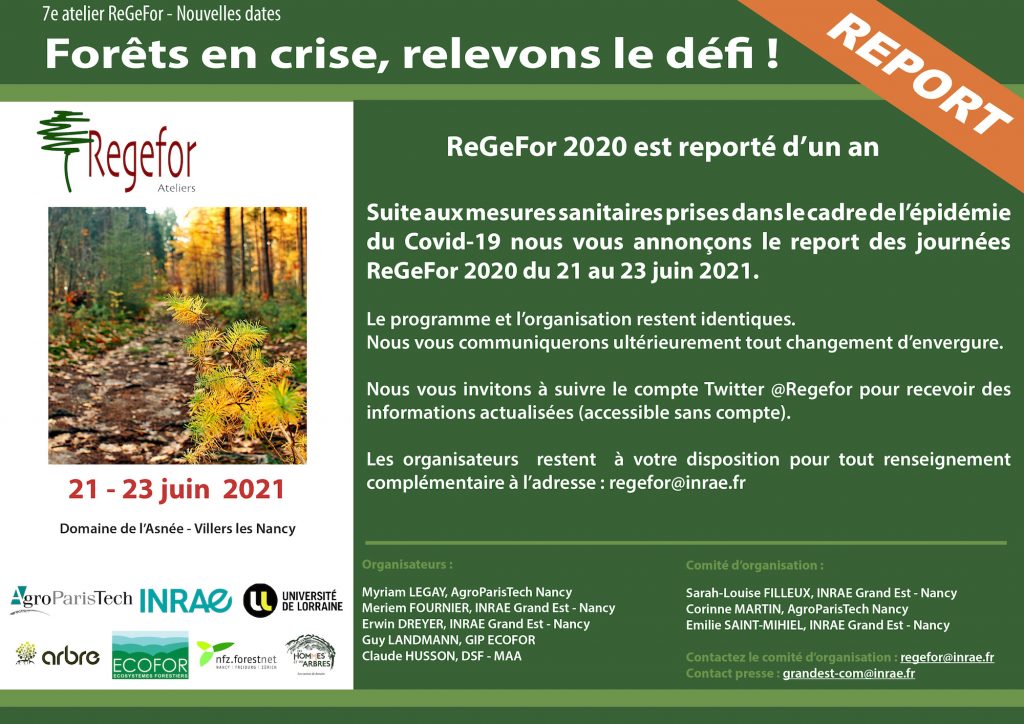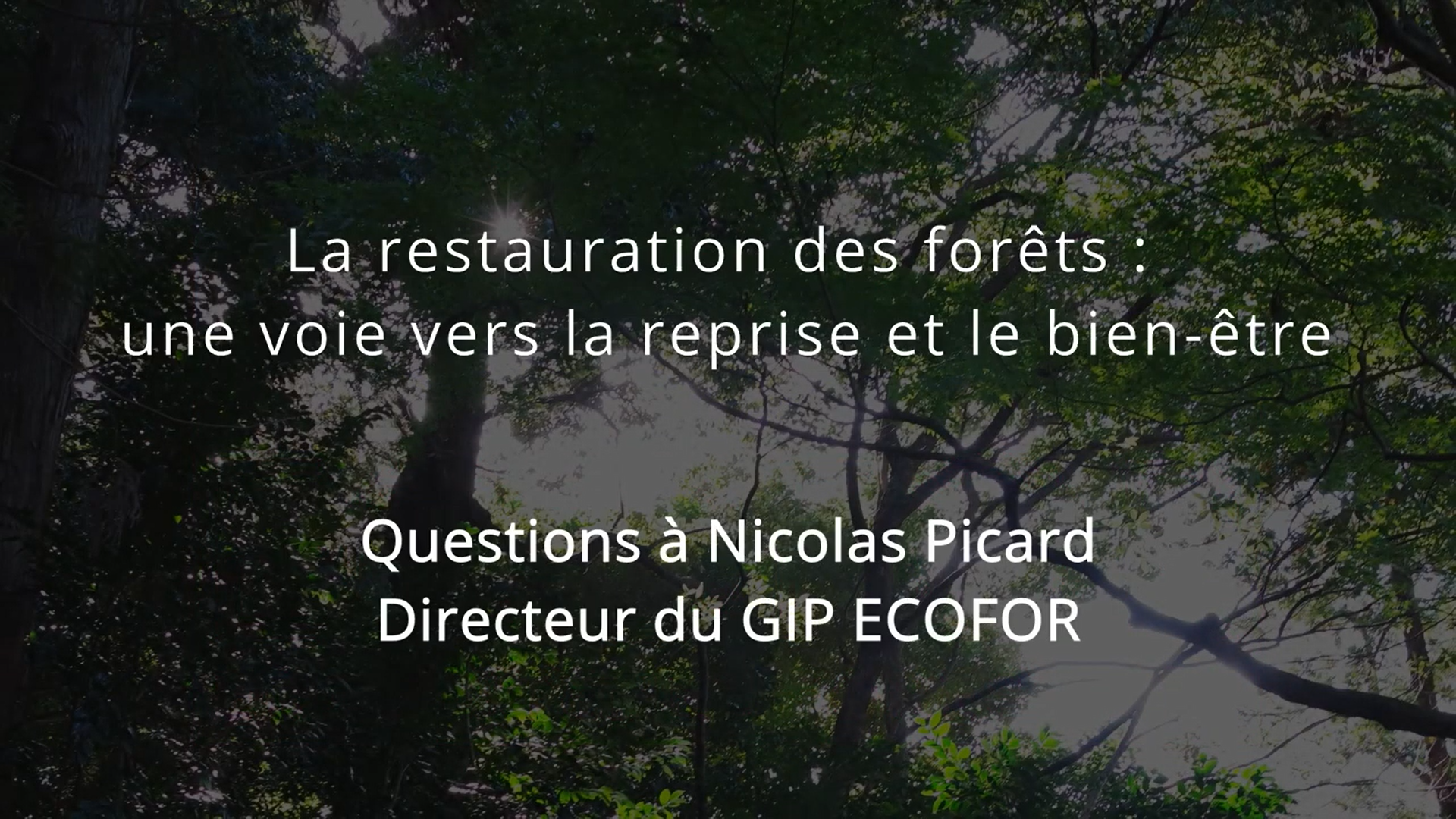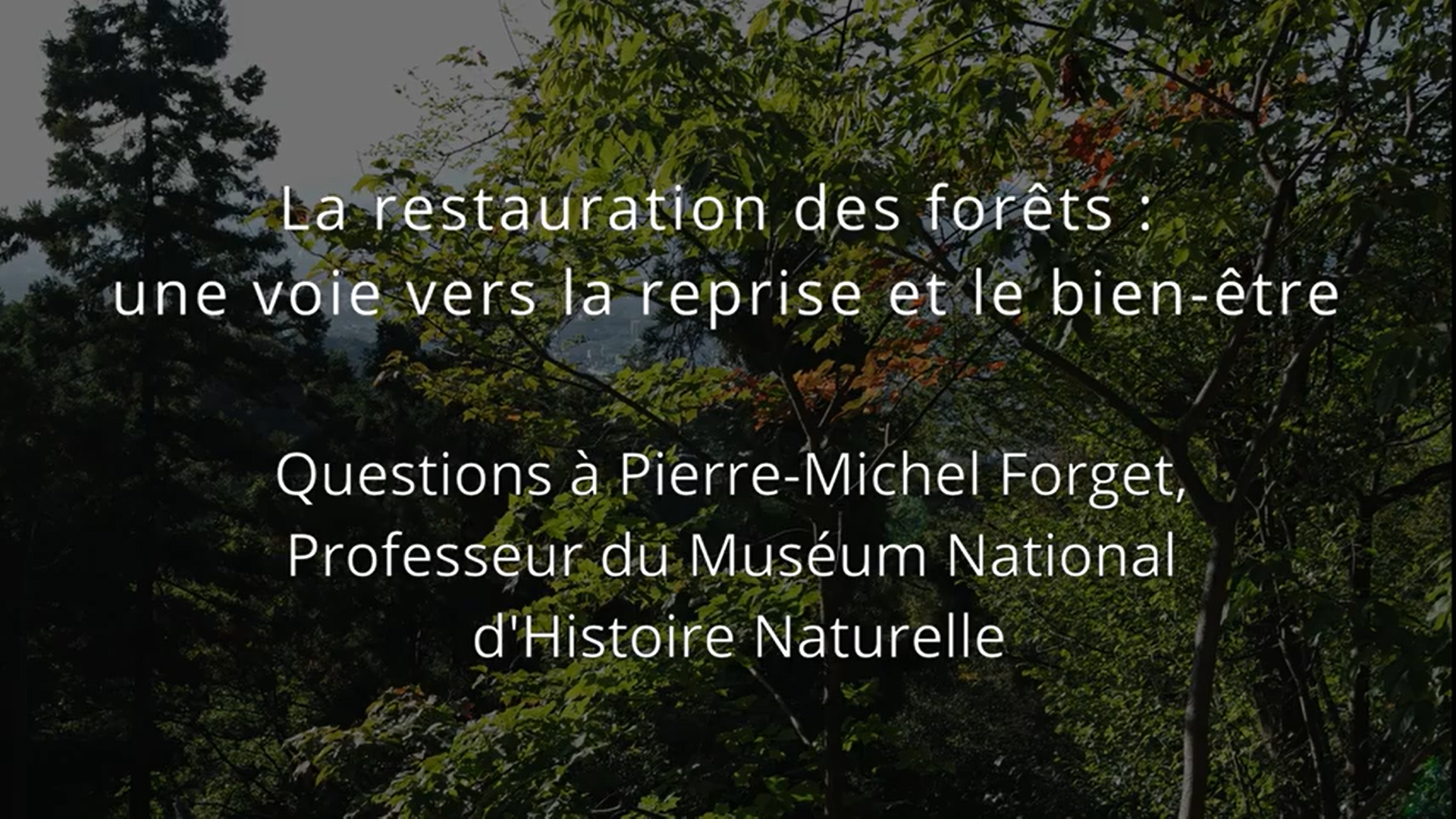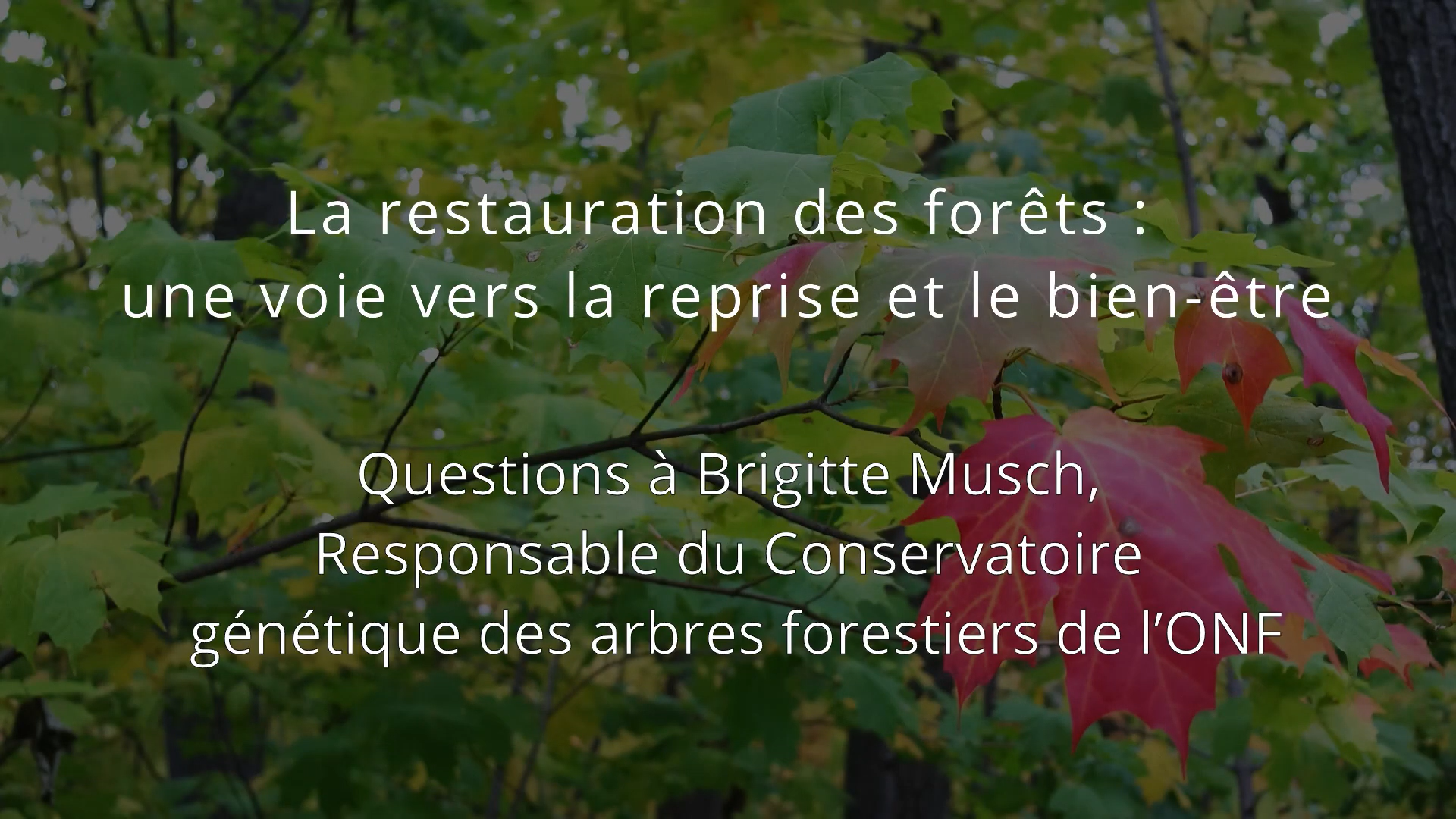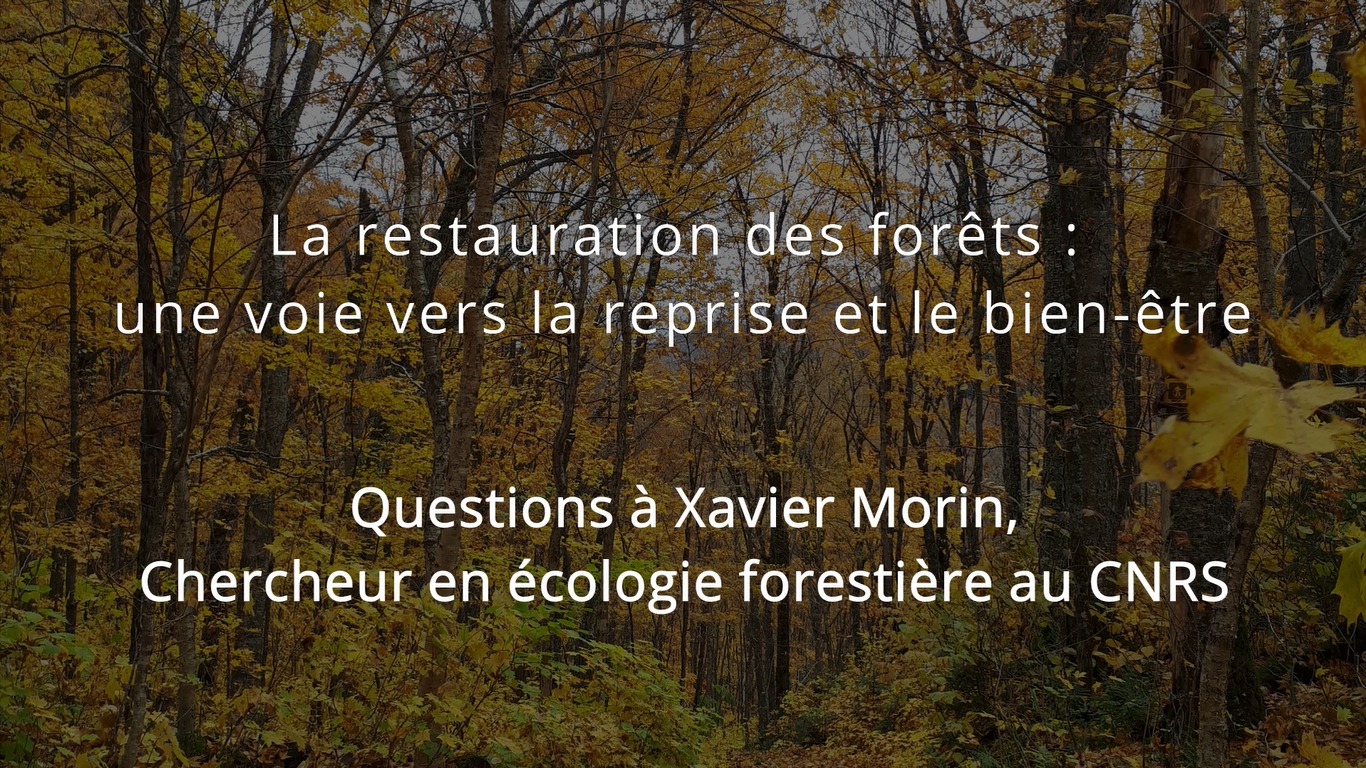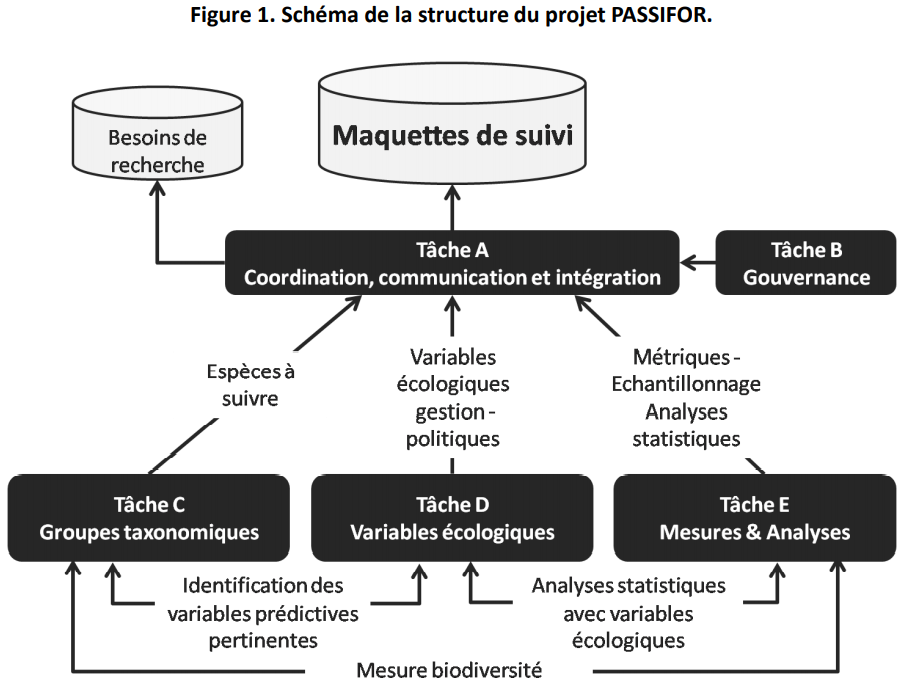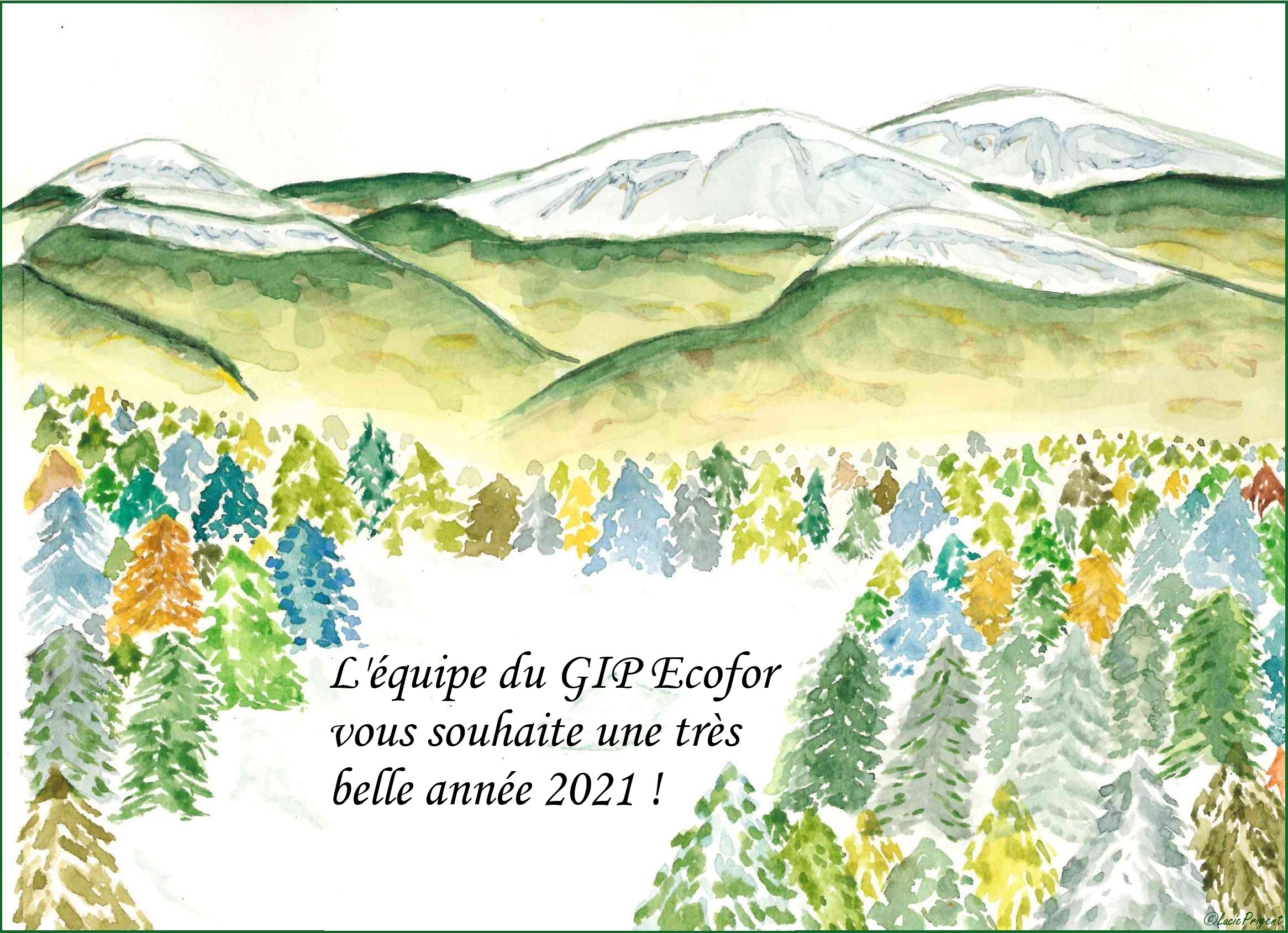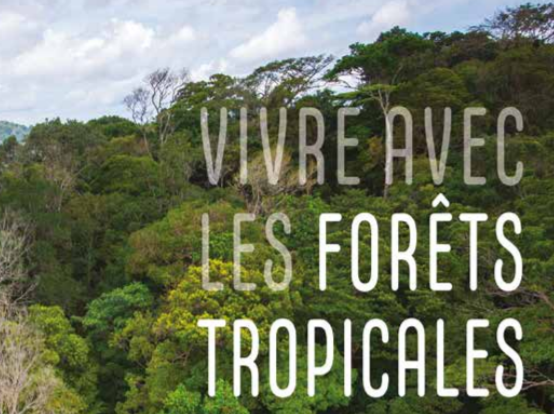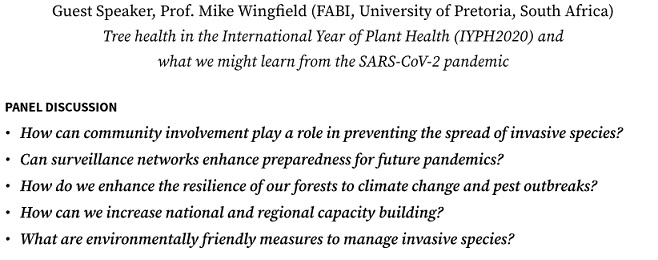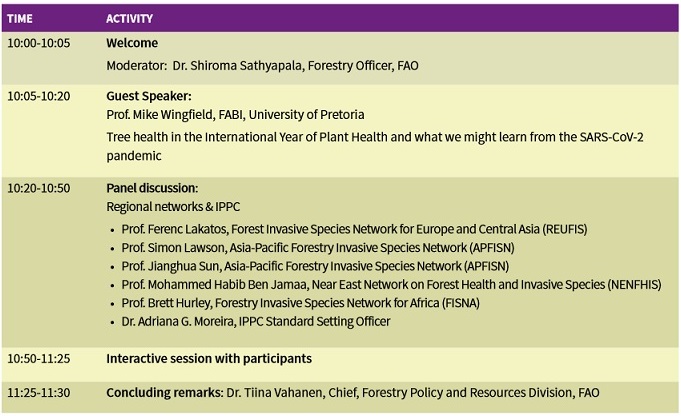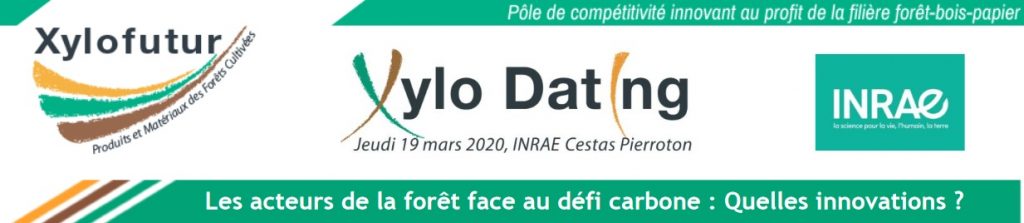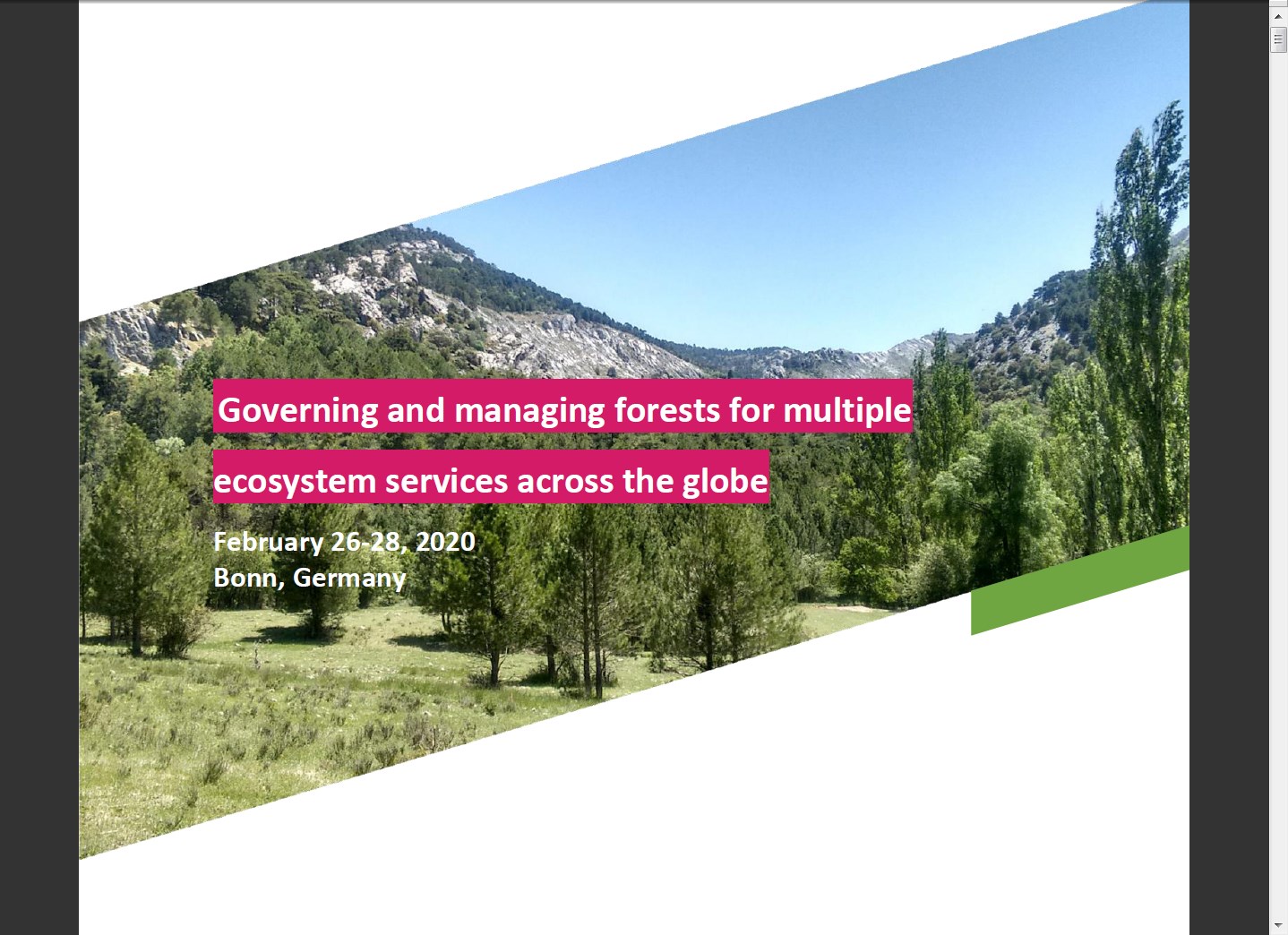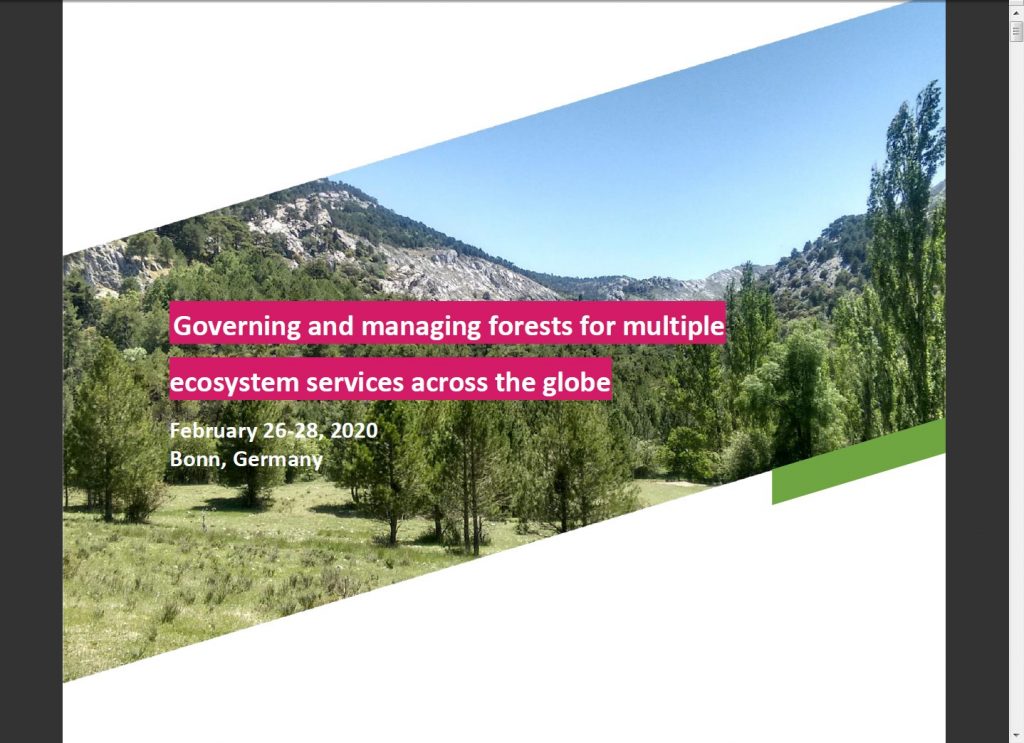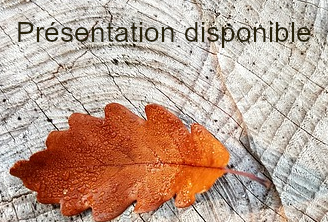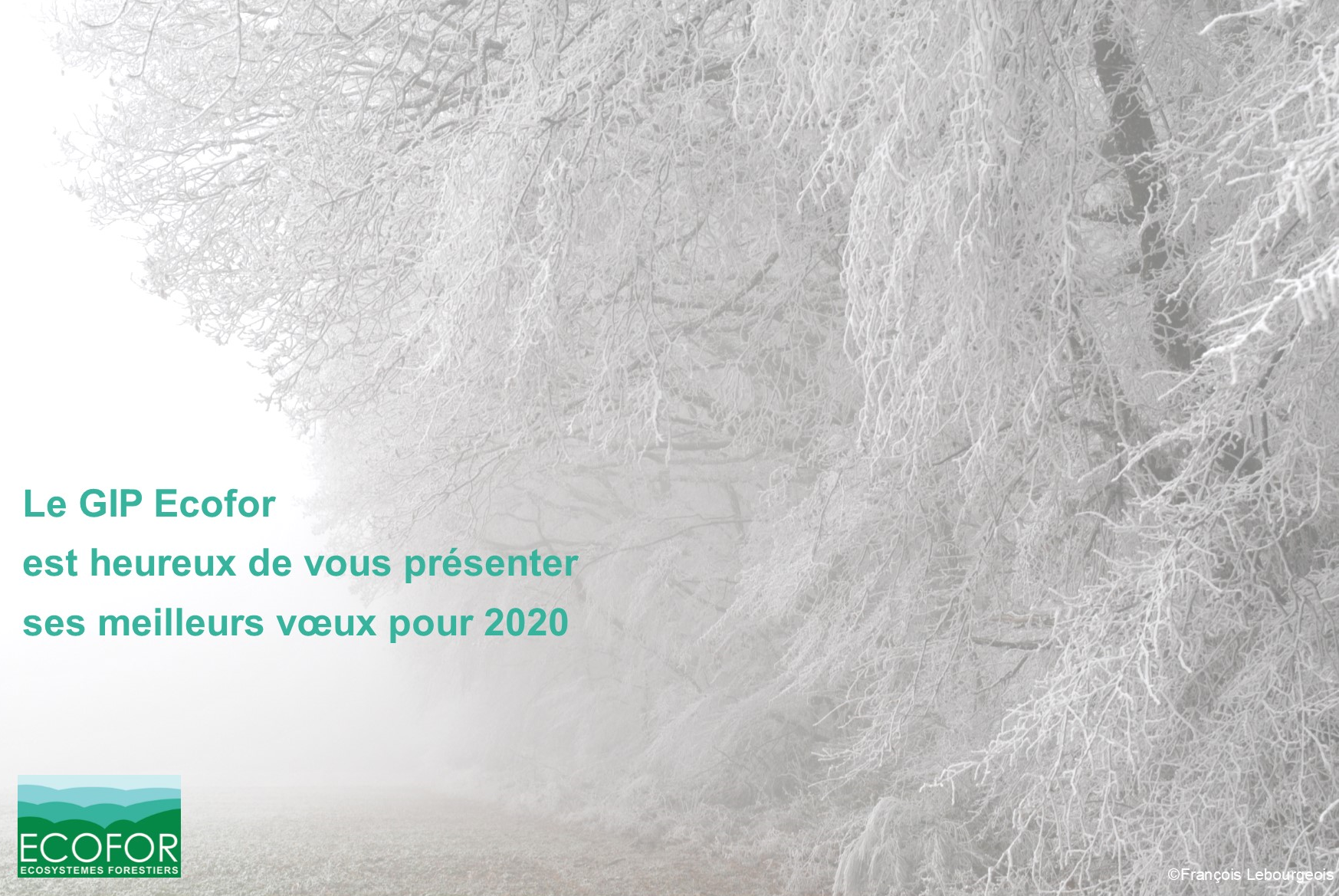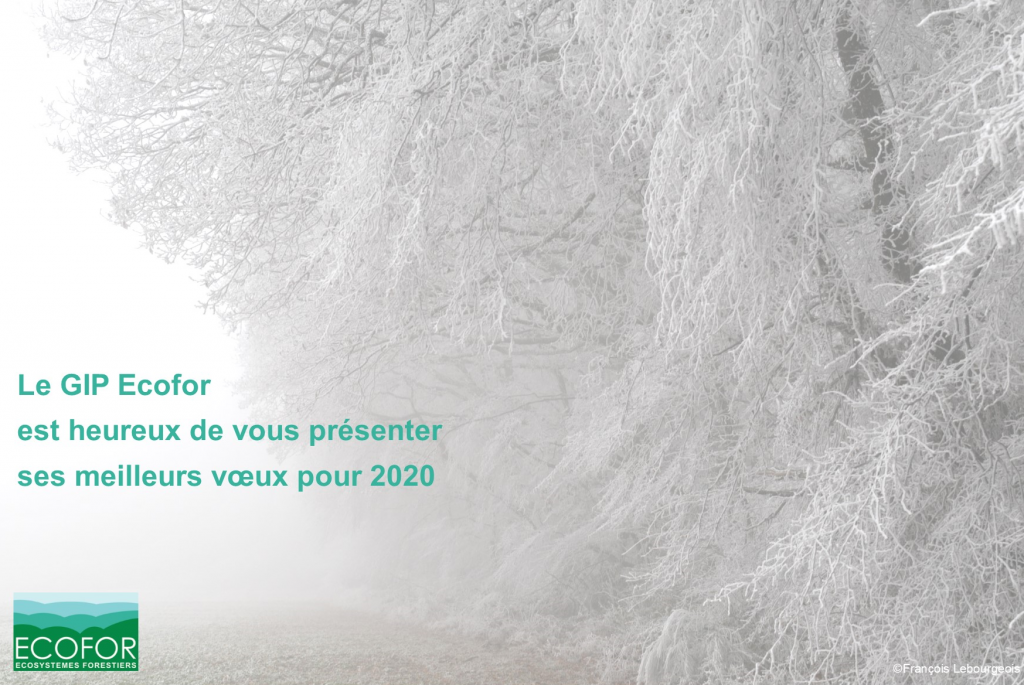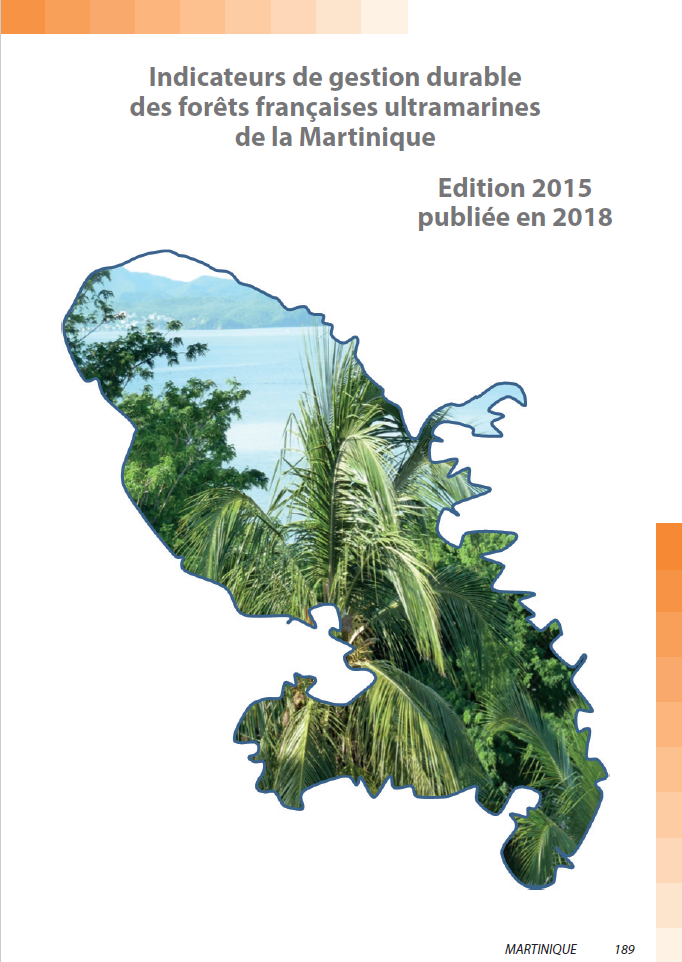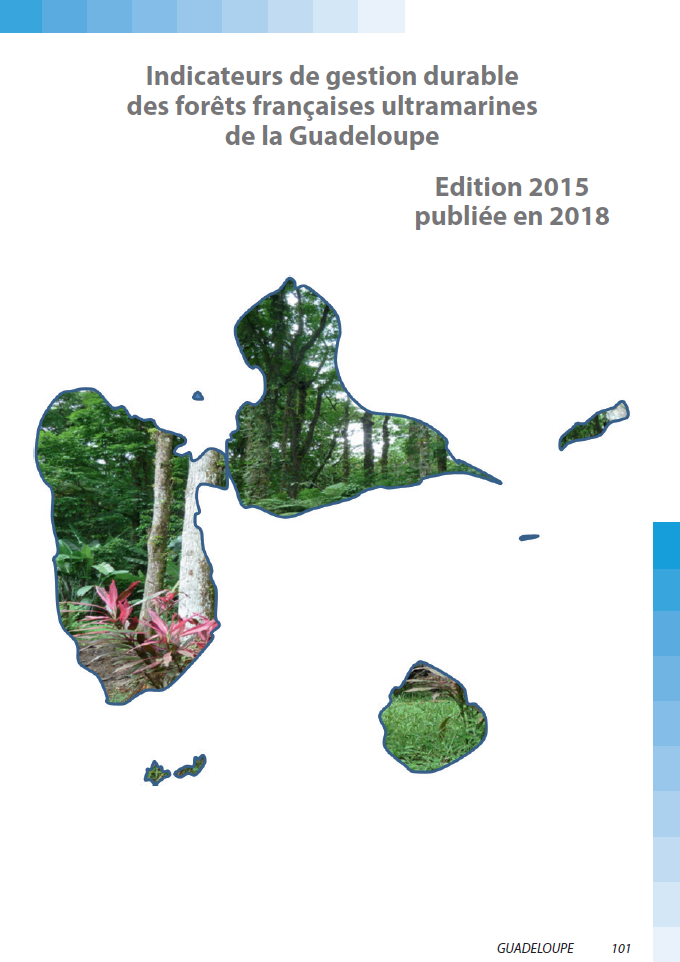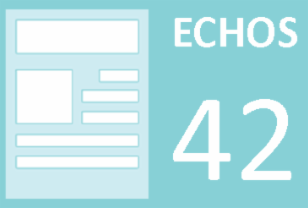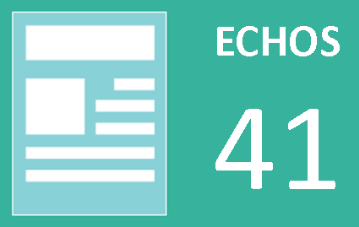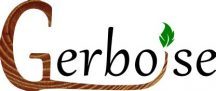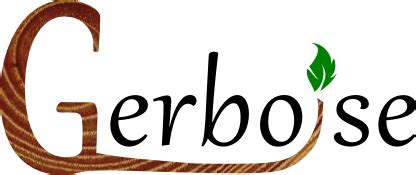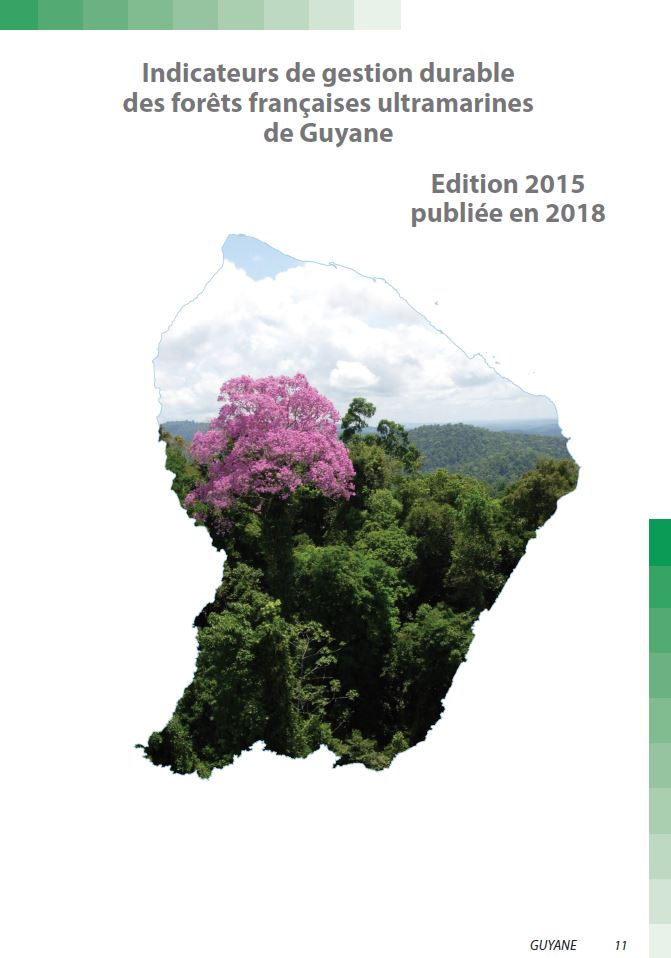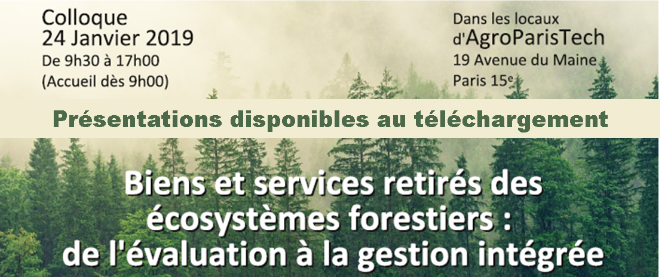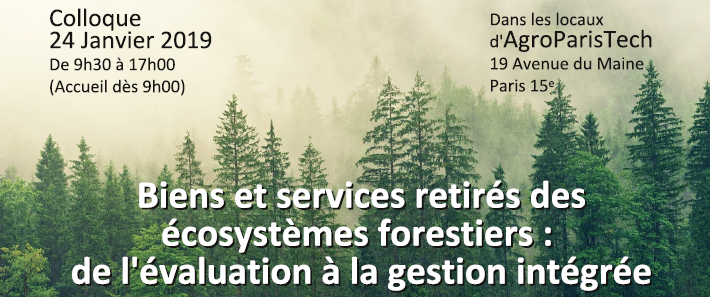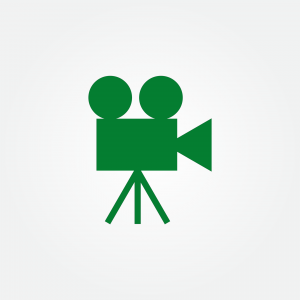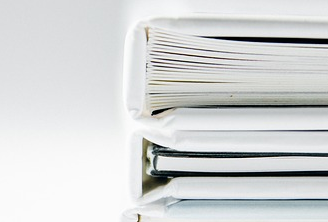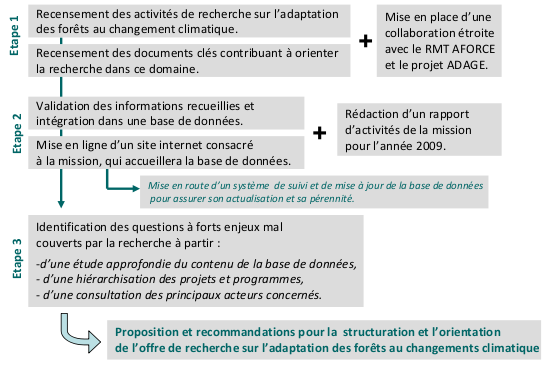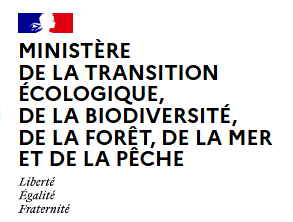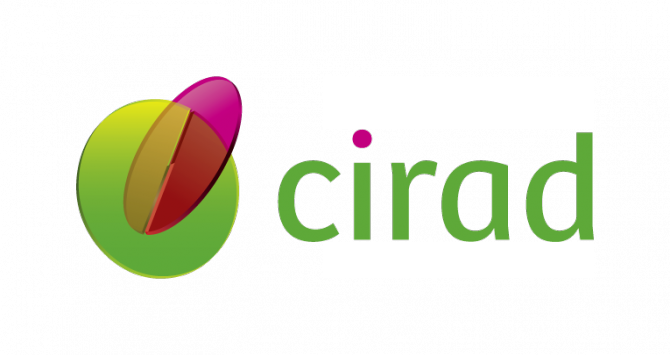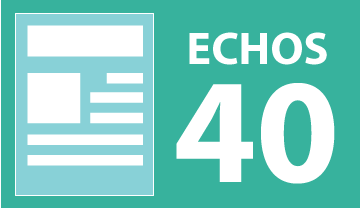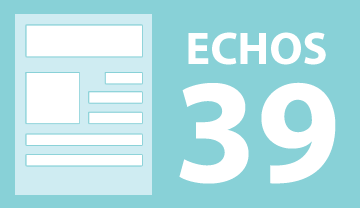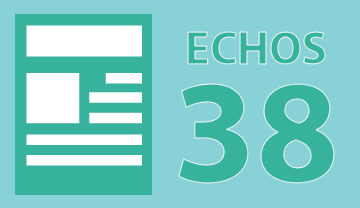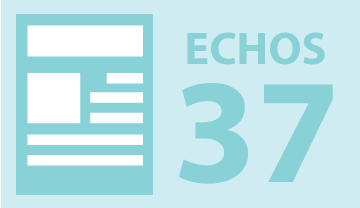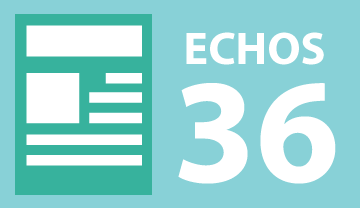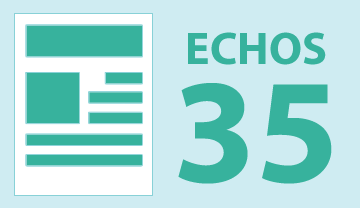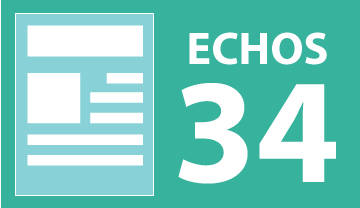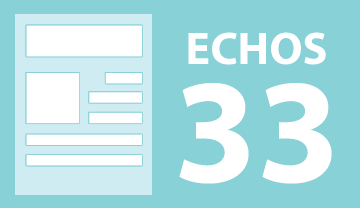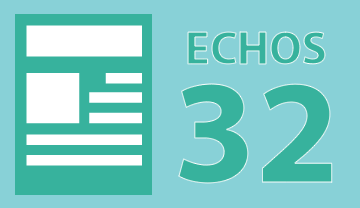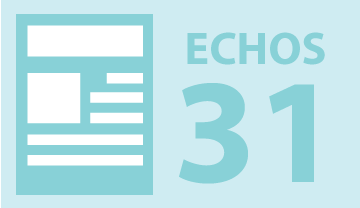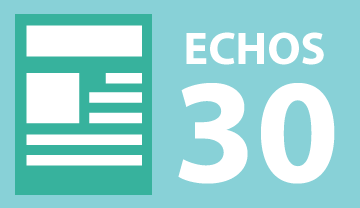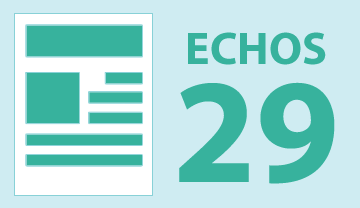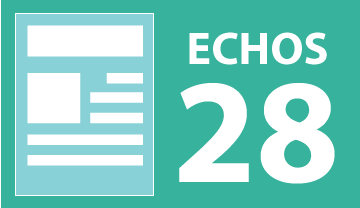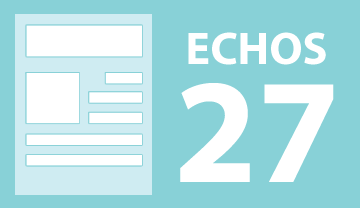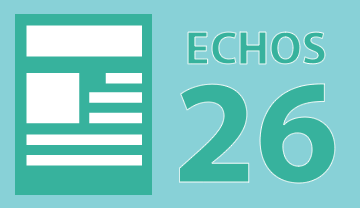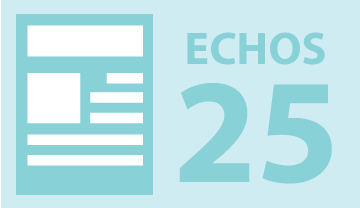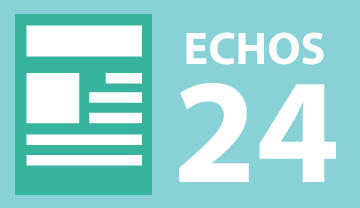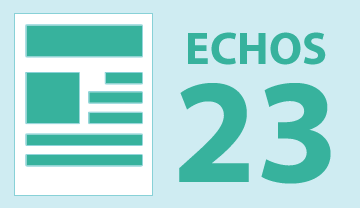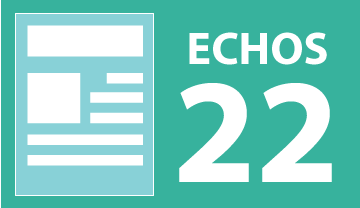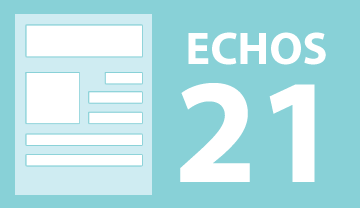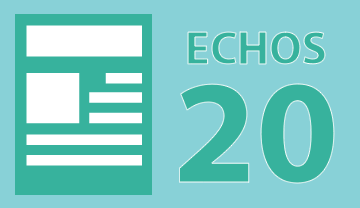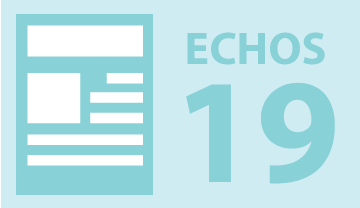Changement climatique et autres risques
Le pacte vert pour le
climat : La Commission européenne a publié son pacte
vert (Green Deal) pour le climat avec pour ambition de faire de l’Europe le
premier continent neutre climatiquement d’ici 2050.
Etat et avenir des
politiques environnementales de l’UE : L’Union européenne a publié le
rapport « EU
environment and climate change policies : State of play, current and
future challenges – Study » où la forêt joue un rôle
Impact du changement
climatique sur les peuples dépendants des forêts : La FAO a publié en
anglais un rapport sur “Climate
change vulnerability assessment of forests and forest-dependent people : A
framework methodology »
La forêt
luxembourgeoise très endommagée : L’inventaire phytosanitaire annuel
des forêts révèle pour 2018 que la moitié des forêts du Luxembourg se trouvent
fortement endommagées. Le gouvernement a mis en place le «Klima-Bonus»
pour la forêt pour soutenir les gestionnaires forestiers dans la mise œuvre
d’une gestion durable des forêts tenant compte du changement climatique.
Gestion durable et services écosystémiques
Prélèvement de bois
en forêt : Selon l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) les prélèvements
de bois en forêt au regard de l’accroissement des arbres auraient été de
56%, sur la période 2008-2016, en légère augmentation par rapport à la période
2005-2013. Le détail de l’indicateur est développé sur le site Internet, de
même que d’autres indicateurs comme la conservation du patrimoine génétique des
arbres en forêts.
Création d’un 11e
parc national : Situé entre la Côte-d’Or et la Haute-Marne ce nouveau
parc national est consacré
aux forêts et a vu le jour par le décret
n° 2019-1132 du 6 novembre 2019
Plantations de forêts
en Europe : L’Institut européen de la forêt (EFI) a publié, en
anglais, un rapport
sur les défis et opportunités pour des plantations de forêts en Europe.
La scierie de
feuillus du futur : Le rapport d’études
« La scierie de feuillus du futur. Quels choix stratégiques pour demain
? », mené par Forestry Club de France et des trois cabinets
Conseil&Stratégie durables, Cyme Innovations et Five Conseil, se propose de
répondre à la question du type d’industrie qu’il convient de développer à
moyen terme pour répondre aux besoins des marchés.
Connections entre
l’eau et la forêt : La FAO a produit le guide “Advancing the forest and water nexus – a
capacity development faciliation guide” afin d’aider les
techniciens, les communautés locales et les politiques publiques à mieux
comprendre les connections entre l’eau et les forêts.
Présentations du colloque
sapin pectiné : Les présentations
la journée du 24 octobre 2019 organisée par FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes sont
disponibles
Biodiversité
Résultats de projets
européens sur la biodiversité : La Commission européenne a publié le
pack de résultats CORDIS sur la biodiversité dans son rapport
« Biodiversité et services écosystémiques : protéger les services
écologiques de la planète ». Il constitue en un regroupement des
résultats de la recherche et de l’innovation financée par l’Union européenne.
Fonds pour la
biodiversité : La France signe la
création d’un fonds fiduciaire dédié à la biodiversité avec la Banque
Interaméricaine de Développement (BID). Il soutiendra des projets pour le « soutien
des forêts tropicales du continent, en particulier dans le bassin amazonien ».
Un nouvel accord ONF
–FNE pour les forêts : L’ONF renforce son partenariat avec France
Nature Environnement (FNE) au travers de deux
nouvelles conventions pour mieux intégrer la biodiversité dans la gestion
forestière et aider les forêts face au changement climatique.
Bioéconomie
Note de conjoncture
de l’ONF : La lettre
de conjoncture de décembre 2019 fait état de la situation du marché du bois
en France à l’automne 2019
Un nouveau radar pour surveiller la déforestation : Des
producteurs et acheteurs d’huile de palme s’unissent pour investir dans un
nouveau système de surveillance de la forêt, le Radar Alerts for Detecting
Deforestation (RADD), qui sera dirigé par le World Resources Institute
(WRI) et accessible d’ici 2021 sur Global Foret Watch. Il utilisera les données
de l’agence spatiale européenne afin d’avoir « une meilleure résolution,
de couvrir une plus grande zone et de pénétrer dans la couverture nuageuse ».
Débardage par câble
aérien favorable à la protection des sols : La FNEDT et l’ONF ont publié
le rapport « Le
débardage par câble aérien : une solution pour la gestion durable des
forêts » pour une technique en développement qui permet d’accroître la
mobilisation des bois en France, y compris en Outre-mer.
Information, recherche et politiques publiques
2020 sera l’année de
la santé des végétaux : La FAO a lancé la prochaine année
internationale qui portera, en 2020, sur la santé des
végétaux. « L’objectif
est de sensibiliser à l’importance de la santé des végétaux dans la réalisation
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; mettre en avant des
effets de la santé des végétaux sur la sécurité alimentaire et sur les
fonctions écosystémiques ; et de partager des meilleures pratiques pour
préserver la santé des végétaux, tout en protégeant l’environnement ».
Les élus s’engagent
pour les forêts : La Fédération nationale des communes forestières
(FNCOFOR) et l’ONF ont publié « Adaptation
au changement climatique : les élus s’engagent pour les forêts »
Intégrer des enjeux
forestiers dans les Plans climat-air-énergie territoriaux : L’ADEME a
réalisé, avec la Fédération nationale des Communes forestières, le rapport « Favoriser
l’intégration des enjeux forestiers dans vos Plans Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET) ». Son objectif est de donner des éléments de
réponses aux élus et aux services des collectivités en charge d’un PCAET.
Assises de la forêt
et du bois en Bretagne :
Les présentations des Assises de la forêt et du bois en Bretagne du 18 octobre
2019 sont
disponibles en ligne.
Horizon Europe, vers un plan stratégique : La Commission européenne a publié, le 31 octobre 2019, le rapport “Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe : Revised following the co-design process”. Les annexes 5 et 6 intègrent la forêt dans la réflexion pour le plan Horizon Europe à venir.
Appels à projets
Master Erasmus Mundus MeDfOR : Le programme de master Erasmus Mundus MEDfOR (foresterie méditerranéenne et gestion des ressources
naturelles) est ouvert jusqu’au 31 décembre 2019 pour les étudiants non
européens. Il sera étendu jusqu’en avril et juin 2020 pour les étudiants de
l’UE.
AAP AURABOIS 2020 :
L’ADEME a lancé l’appel à projets AURABOIS pour
faciliter la création d’une chaufferie biomasse supérieure à 1200 MWh/an sans
raccordement à un réseau de chaleur. Les dossiers sont à envoyer avant le 17/01/2020
Emploi
CDI Référent technique forestier (H/F)
– Reforest’Action
Stage – Responsable des projets forestiers
(H/F) – Reforest’Action
Un⋅e
chargé⋅e d’études Botaniste Zones Humides– Biotope – Nancy
Contrat de post doctorant : Projet
Patribois, financé par la fondation des sciences du patrimoine – Contacter : emmanuel.maurin@culture.gouv.fr
, 06 89 51 07 00
Post-doctorat : « Rôle des forêts
dans l’atténuation du changement climatique : Comment la sylviculture
peut moduler les flux et stocks de carbone des écosystèmes forestiers de
plaine? » – Nogent sur Vernisson – Jusqu’au 15 décembre 2019
Offre Stage Master 2. Agronomie,
Environnement : « Géolocalisation de déchets maraîchers et de
bois dans la région nantaise pour une utilisation en bioraffinerie et
évaluation de la durabilité » – 2020
Head of Resilience Programme – EFI
Bonn – Jusqu’au 6 janvier 2020
Stage M2 « Distribution verticale de
la consommation de méthane par les sols forestiers » – Laboratoire
SILVA, INRA – Jusqu’au 31/01/2020
Senior professional to lead EFI’s Resilience Programme – EFI – Jusqu’au 06/01/2020.
Chargé(e)de mission CDI –
SalvaTerra – Avant le 10/01/2020
Stage M2 « Evaluation de la qualité
des bois à partir de l’analyse de sections de grumes » – Laboratoire SILVA, INRA – Jusqu’au
31/01/2020
Stage « Les branches comme source
potentielle d’extractibles forestiers » –INRA , Université de
Lorraine – Jusqu’au 01/02/2020
CDD Soutien scientifique pour la
coordination EUFORGEN – EFI Barcelone – Jusqu’au 06/01/2020
Agenda
08/01/2020, Deux séminaires Agroforesterie
sur le thème du fonctionnement du sol de systèmes agroforestiers tempérés,
organisé par l’INRA, Champenoux
25
/01/2020, Journée d’étude « Mobilisations et conflits forestiers hier
et aujourd’hui », organisée par le GHFF, Paris
27-31/01/2020, Conférence scientifique
« Genetics for sustainable forest management »,organisé par le
projet H2020 GenTree, Avignon
29/01/2019, Séance publique de l’Académie
d’Agriculture de France « Le secteur forêt-bois peut-il faire mieux pour le
climat? », Paris, 18 rue de Bellechasse
23-28/02/2020, Forum mondial de la
biodiversité, organisé par Future Earth et ses partenaures, Davos
(Suisse)
26-28/02/2020, Conférence
interdisciplinaire “Governing and managing forests for multiple ecosystem
services across the globe”, organisée par INFORMAR (EFI Bonn),
Polyfores et leurs partenaires à Bonn (Allemagne).
03-05/03/2020, Conférence « Managing forests in the 21st
century »,
Postdam
05-07/03/2020, Colloque international
pluridisciplinaire « La forêt. Représentations/imaginaires nordiques »,
organisé conjointement par l’Université de Tartu et l’Université du Québec à Montréal
à l’Université de Tartu (Estonie)
09-13/03/2020, Symposium IUFRO sur le
nématode du pin, organisé par l’IUFRO et l’INRA à Orléans. Inscriptions
du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020.
11/03/2019, Colloque « Certification de la gestion durable des forêts », organisé par l’Académie d’Agriculture de France au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation , Paris (Salle Gambetta)
23/03/2020, Journée internationale des
forêts sur le thème « Forêts et biodiversité », Genève, Suisse
25-27/03/2020, Conférence “Mixed species
forests: Risks, Resilience and Management”, organisé par l’IUFRO et l’université suédoise des sciences
agronomiques, Suède.